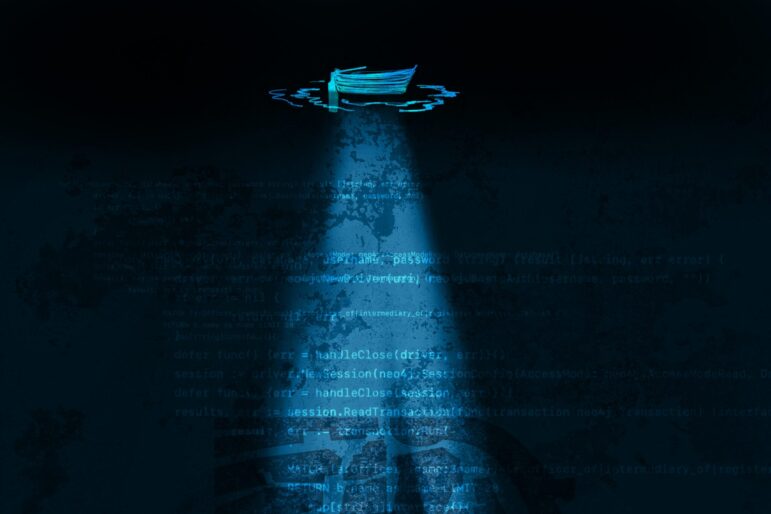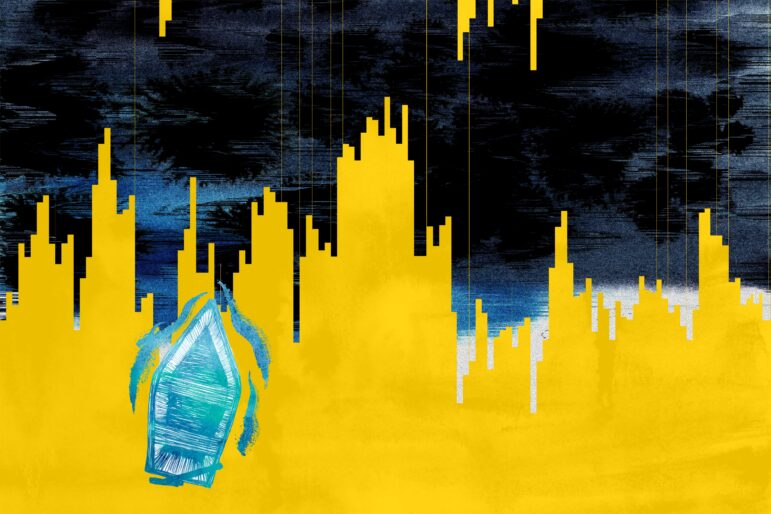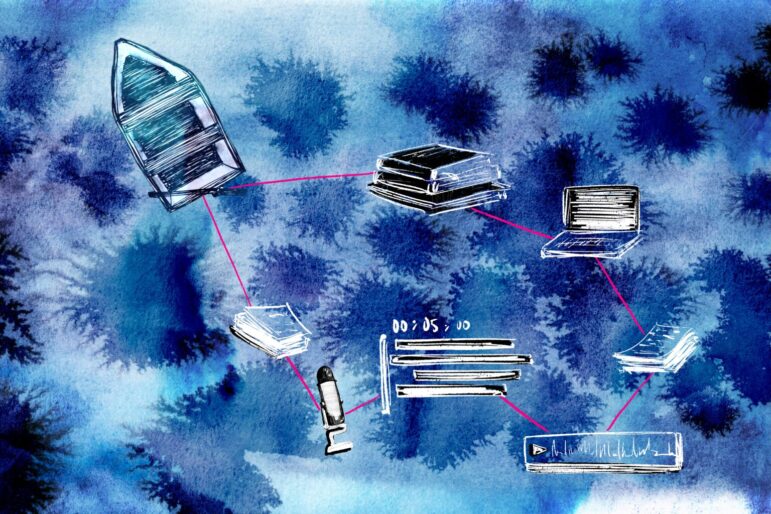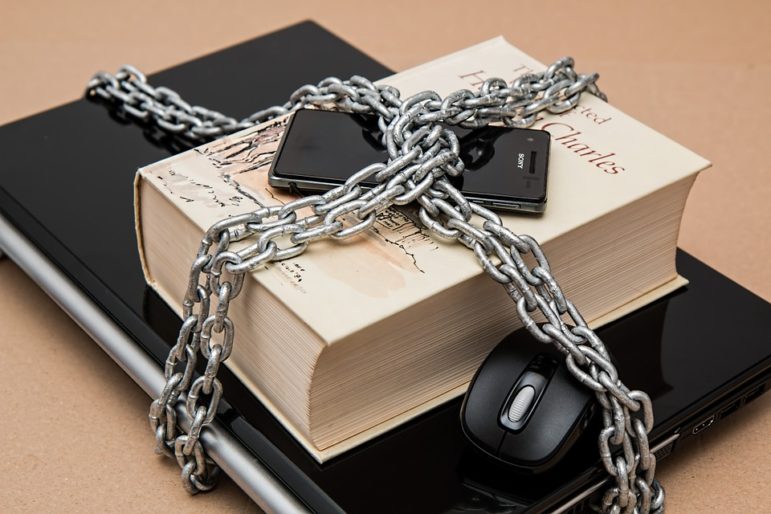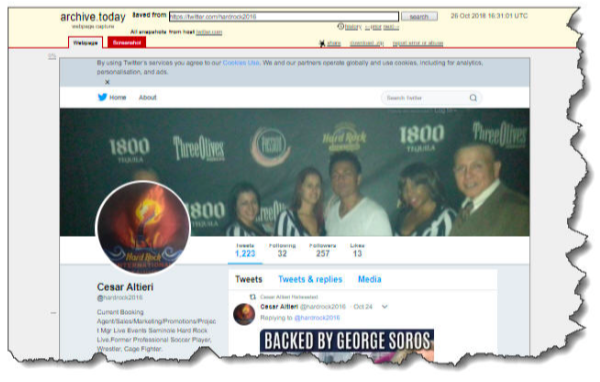Illustration: Smaranda Tolosano pour GIJN
Introduction au journalisme d’investigation : identifier des sources, rechercher les antécédents d’une personne, les archives publiques et l’accès à l’information
Lire cet article en
Guide Ressource
Guide d’introduction au journalisme d’investigation
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : techniques d’interview pour les débutants
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : traquez l’argent
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : le data-journalisme
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : le fact-checking
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : la sécurité numérique
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : les collaborations
Chapitre Guide Ressource
Introduction au journalisme d’investigation : comment éditer une enquête
La journaliste indienne Srishti Jaswal avait fait connaissance avec ses sources deux ans avant qu’elles ne deviennent des personnes clés dans le cadre de son enquête sur la propagande du parti au pouvoir en Inde.
La journaliste indépendante, qui participé au programme du Pulitzer Center sur l’IA et la responsabilité (AI Accountability), a collaboré avec le Digital Witness Lab de l’Université de Princeton pour enquêter sur l’utilisation de WhatsApp par le parti de Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP) pour la campagne lors des élections générales de 2024 en échappant à tout contrôle public. L’enquête reposait sur des données, mais elle a aussi bénéficié des relations sur le long terme de la journaliste avec ses sources : des personnes payés pour mener la campagne sur la plateforme de messagerie.
“Je crois que de nombreux journalistes n’ont pas la patience d’entretenir le contact avec leurs sources sur la durée. La patience et le temps sont deux éléments clés. L’Inde est si polarisée que beaucoup hésitent à interroger des sources qui sont membres du BJP”, a-t-elle répondu quand on lui a demandé comment elle avait identifié des sources pour son enquête.
Srishti Jaswal a consacré du temps non seulement à obtenir davantage d’informations auprès de ses sources, mais aussi à établir une relation professionnelle avec elles. En fait, quand elle a rencontré les employés du BJP, elle ne savait pas encore qu’elle réaliserait cette enquête. Après tout, la propagande politique en Inde, comme dans beaucoup d’autres pays, a cours toute l’année. La journaliste était curieuse de savoir en quoi consistait le travail de ces employés, et pourquoi ils le faisaient. Peu à peu, elle a gagné leur confiance et, de son côté, elle a appris beaucoup de choses sur ce milieu, le genre d’information que les journalistes d’investigation cherchent à obtenir. Plus tard, à l’approche des élections, un événement politique de la plus haute importance, Srishti Jaswal se trouvait dans une situation idéale pour réaliser une enquête sur le sujet.
L’expérience de Srishti Jaswal montre qu’identifier des sources ne consiste pas seulement à rechercher des personnes à interviewer. Il s’agit aussi d’instaurer la confiance et d’entretenir la relation avec elles. Plus elle en apprenait sur leur monde, plus elle gagnait leur confiance et leur respect, et plus il lui était facile de comprendre ce que ces personnes faisaient exactement.
En fin de compte, identifier des sources est un processus qui commence quand on réfléchit aux raisons qui font que l’on recherche des sources, et qui se poursuit même lorsqu’on arrête d’enregistrer l’interview. Dans ce volet, nous vous proposons un guide, étape par étape, pour identifier des sources dans le cadre d’une enquête, ainsi que des conseils et des outils pour chacune des étapes.
Comment identifier des sources (personnes et documents)
Quand vous recherchez une source, fixez-vous un objectif. Selon la définition de Mark Lee Hunter, adaptée par la suite par Eva Constantaras et Anastasia Valeeva pour les enquêtes reposant sur des données, une enquête porte sur :
- Le présent (ce qui se passe maintenant, ou le “problème”) ;
- Le passé (comment on en est arrivé là, ou la “cause”) ;
- L’avenir (voici ce qui se passera si rien ne change… et voilà comment on pourrait améliorer la situation, ou l’“impact” et la “solution”).
Si l’on suit ce cadre, on peut penser à des sources (personnes et documents) en fonction des informations et des preuves qu’elles peuvent nous fournir. Les études de cas, souvent parmi les membres des communautés affectées par des programmes et des politiques, sont fréquemment recherchées pour nous aider à mieux comprendre l’impact des actions et décisions gouvernementales, par exemple. Les autorités, les entrepreneurs ou les personnes potentiellement responsables sont ensuite poursuivi pour établir des lien de cause à effet. On peut aussi interviewer dans une enquête des experts en tant que sources pour expliciter l’impact d’un problème et sa solution.
Par exemple, une ancienne journaliste multimédia du Philippine Center for Investigative Journalism (PCIJ), Cherry Salazar, a passé plusieurs jours avec les pêcheurs des quartiers côtiers de la ville de Batangas, aux Philippines, pour savoir comment leur mode de vie est affecté ou “impacté” par les projets d’exploitation du gaz naturel liquide (GNL) qui sont en train de voir le jour sur leur zone de pêche. Les projets d’exploitation du GNL sont considérés comme le “problème” dans l’enquête.
Elle évoque la stratégie qu’elle adopte quand elle sélectionne les personnes qu’elle va interviewer. “J’essaie toujours de trouver des personnalités captivantes qui incarnent et ‘humanisent’ le reportage. Quand c’est possible, je préfère aussi les interviews qui permettent de résoudre deux problèmes à la fois.”
Le personnage principal de Cherry Salazar dans The Last Fishermen of Ilijan (“Les derniers pêcheurs de Ilijan”) est un pêcheur dont les ancêtres pratiquaient également la pêche. Ainsi, il a pu décrire et comparer les prises de poisson avant et pendant le projet de construction. Il a aussi indiqué qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un des emplois proposés par les responsables du projet sur le site de construction, en raison de son âge.
“Cette interview a illustré à la fois l’impact des projets d’exploitation du GNL sur la communauté de pêcheurs, et le fait que les emplois censés être proposés n’avaient en fait qu’un caractère symbolique”, a indiqué la journaliste.
Elle a ensuite déterminé la “cause” en mobilisant des documents, des données et des interviews avec des experts et avec les autorités pour décrire le “pas de côté” du gouvernement philippin au sujet des énergies renouvelables.
L’idée n’a rien d’extraordinaire, mais le fait de définir des objectifs clairs ou de savoir quel genre d’information on peut obtenir auprès de telle ou telle source peut aider à définir des stratégies pour les identifier. Les interviews à fort impact, comme celles que Cherry Salazar et Srishti Jaswal ont réalisées, sont de celles qui nécessitent que l’on y consacre beaucoup de temps pour permettre aux sources d’être suffisamment à l’aise pour parler aux journalistes. Les experts, quant à eux, peuvent être identifiés à mesure que l’enquête progresse, notamment à la lueur de nouveaux éléments. En revanche, les interviews dans lesquelles on demande des comptes, par exemple aux autorités ou aux représentants de sociétés privées, doivent être faites une fois qu’une bonne partie de l’enquête a déjà été réalisée.
Recherchez des sources “actuelles”, “anciennes” et des lanceurs d’alerte mais faites attention!
Dans son ouvrage, “The Investigative Reporter’s Handbook: A Guide to Documents, Databases, and Techniques,” Brant Houston classe les sources potentielles en les divisant entre “actuelles” et “anciennes”. Les sources “actuelles” sont des personnes qui appartiennent à une infrastructure ou qui sont actuellement en relation avec elle, par exemple des secrétaires, des employés ou des fournisseurs, des entrepreneurs ou des consultants. Ces personnes sont relativement faciles à identifier dans des annuaires en ligne ou auprès de journalistes qui couvrent les agences au quotidien. Les sources “anciennes” sont les personnes qui ont appartenu à une structure ou qui ont été en relation avec elle par le passé.
Le fait de savoir quelles informations ces sources sont susceptibles de vous fournir, et en quoi ces informations peuvent être limitées, ainsi que les raisons qui poussent ces sources à vouloir parler, devrait aider les journalistes à mieux planifier les interviews et à les réaliser.
Intéressons-nous, par exemple, aux accusations de délit d’initié formulées dans le cadre de projets routiers dans la juridiction d’un haut responsable. Les anciens entrepreneurs sont bien plus susceptibles de parler librement de la manière dont les choses se sont passées quand ils ont répondu à un appel d’offres, mais ils ne seront pas forcément au courant de l’évolution récente du processus de passation de marchés. Les entrepreneurs actuels, eux, sont susceptibles de faire preuve de prudence lors de leurs entretiens avec des journalistes. Ils peuvent aussi accepter de ne parler que du “contexte” ou de ne s’exprimer que sous couvert d’anonymat. Comprendre ces différents scénarios, savoir ce que les gens ont à gagner ou à perdre en accordant une interview, doit guider les journalistes pour savoir comment approcher leurs sources.
Les lanceurs d’alerte constituent un autre type de sources, qui peuvent être “actuelles” ou “anciennes”. Brant Houston écrit à leur sujet qu’ils peuvent “soit chercher à se faire remarquer, soit se retrouver involontairement sous les projecteurs parce qu’ils sont au courant de malversations”. Il est important de révéler les fraudes commises, que ce soit par les autorités publiques ou par le milieu des affaires, mais les pays n’offrent pas les mêmes conditions. En effet, toutes les juridictions ne prévoient pas forcément de lois qui protègent les lanceurs d’alerte, surtout celles qui ne jouissent pas d’une démocratie totale.
Les lanceurs d’alerte altruistes peuvent fournir des informations exactes mais, comme pour tout autre élément de preuve, vous devrez procéder à des vérifications auprès de plusieurs sources. D’autres soi-disant lanceurs d’alerte peuvent vous donner des informations inexactes à dessein, et vous induire en erreur, pour des motifs inavoués. Soit ils se sentent lésés et veulent prendre leur revanche, soit ils veulent nuire à votre réputation. Quoi qu’il en soit, les journalistes qui interviewent ces sources, ou qui sont contactés par ce genre de sources, doivent garder à l’esprit qu’il leur faut vérifier chacune de leurs déclarations.
S’efforcer d’avoir un “état d’esprit ‘documents’”
Le journalisme d’investigation est un exercice qui consiste à faire en permanence appel à différentes sources et à procéder à des vérifications. Tout en interviewant leurs sources, les journalistes doivent aussi consulter les archives. En même temps, tandis qu’ils étudient les documents, ils doivent vérifier leurs découvertes auprès d’experts. C’est ce que l’on appelle construire un “mur” de preuves, où les documents et les données sont comme les briques nécessaires à la construction du mur, alors que les interviews sont le mortier qui le consolide. Généralement, les enquêtes ne peuvent pas reposer uniquement sur les déclarations et les faits anecdotiques recueillis lors d’interviews. Il en va de même pour les documents : en effet, comme les humains, les documents peuvent aussi mentir.
L’expression “documents state of mind” (“état d’esprit ‘documents’”), du tandem formé par les journalistes d’investigation américains Donald L. Barlett et James B. Steele, signifie que l’on sait qu’il y a quelque part un document qui permettrait d’étudier chaque élément d’une enquête, de le réfuter ou de le confirmer.
Quand un responsable affirme lors d’une conférence de presse que des projets routiers ont permis à des agriculteurs de sortir de la pauvreté, un journaliste doit être capable d’identifier et d’obtenir les archives nécessaires pour confirmer ou réfuter une telle affirmation. Il peut s’agir de contrats, de rendements agricoles, de portraits de membres de cette communauté ou de données sur l’incidence de la pauvreté.
Nous vous présentons ci-dessous quelques idées pour obtenir des documents. Nous pouvons les classer par source : il peut s’agir de documents provenant des autorités publiques ou d’organisations non gouvernementales (ONG) ou encore de personnes privées.
Autorités publiques
- Organismes publics locaux ou ministères
- Services de répression
- Tribunaux
- Archives nationales
- Bourses ou agences de réglementation des entreprises
ONG ou personnes privées
- Organisations locales de la société civile
- Organisations internationales ou à but non lucratif
- Chercheurs
- Bases de données commerciales
- Registres de propriété
Et, bien entendu, de tels documents peuvent être obtenus en faisant une demande en vertu du droit d’accès à l’information.
Les documents mis à disposition par des responsables sont recevables, mais il ne faut jamais se baser uniquement sur eux. Ces documents vous ont été “pourvus” et, souvent, ils présentent peu d’intérêt dans le cadre de votre enquête. Les journalistes d’investigation doivent identifier les archives dont ils ont besoin et en faire la demande. Il peut s’agir de demandes faites en vertu du droit d’accès à l’information dans les pays où des lois sur l’accès à l’information existent. Dans de nombreux pays, c’est l’une des qualités les plus élémentaires et les plus sous-estimées d’un journaliste.
Deux autres journalistes américains, David Cuillier et Charles N. Davis, ont rédigé un guide complet, “The Art of Access: Strategies for Acquiring Public Records.” Il est important que les débutants connaissent le droit des journalistes à l’information. Tous les pays ne disposent pas (ou n’appliquent pas) de lois sur l’accès à l’information, mais le droit à l’information (DAI) est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains de l’ONU. L’accès à l’information est en effet un droit humain fondamental. Bien que les journalistes n’aient pas toujours des garanties juridiques, beaucoup réussissent malgré tout à obtenir les documents recherchés. Leurs tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès, mais cela ne doit pas les décourager.
Au minimum, les journalistes doivent être capables d’écrire des lettres de demande efficaces, en assurer le suivi de manière systématique et, au cas où on leur remettrait des documents incomplets ou expurgés, ou encore où leur demande se heurterait à un refus, ils doivent apprendre à négocier ou à traiter avec les autorités et avec les fonctionnaires, par exemple en revendiquant le droit des journalistes à l’information, en faisant appel, ou en s’adressant aux supérieurs hiérarchiques. Dans certains cas, les rédactions qui en ont les moyens peuvent aussi porter plainte contre le service concerné.
Comment identifier vos sources
Une fois vos objectifs fixés, vous pouvez recourir à différents outils et à diverses stratégies pour identifier vos sources potentielles. Ce sera plus ou moins facile en fonction du sujet de votre reportage, mais les journalistes d’investigation débutants trouveront ci-dessous quelques conseils d’ordre général qui pourront se révéler utiles.
Lisez les reportages existants. Vérifiez les informations locales et internationales pour vous inspirer de leurs sources. Même si vous travaillez sur un sujet local, des exemples de reportages réalisés ailleurs peuvent vous donner une idée des types de sources que d’autres journalistes ont cherchées et trouvées. Cet exercice vous permet aussi de recenser ce qui a déjà été rapporté sur la question et de déterminer ce que vous pourriez ajouter.
Faites l’inventaire du corpus de recherche actuel et essayez de trouver des sources universitaires. Il est plus que probable que des universitaires aient déjà beaucoup écrit sur le sujet sur lequel vous travaillez. Les chercheurs eux-mêmes sont de bonnes sources potentielles, parce qu’ils peuvent vous aider à comprendre le contexte, ou vous donner de nouveaux éclairages exclusifs. C’est le cas, entre autres, pour les sujets qui nécessitent des connaissances techniques.
Par exemple, dans le cadre de la collaboration entre le PCIJ et NBC News, qui a établi un lien entre la mise en danger des forêts vierges tropicales dans la province de Palawan, aux Philippines, et les constructeurs automobiles aux Etats-Unis, Andrew W. Lehren et son équipe de journalistes à New York se sont entretenus avec un expert sur la qualité de l’eau, et avec un professeur de pédologie pour expliquer le risque que posent des concentrations élevées de chromate dans l’eau. Ces avis d’experts ont confirmé les dires des personnes exposées à cette eau polluée, ce qui a permis de mettre en lumière la nécessité de prendre des mesures contre la contamination.
Demandez des contacts à la société civile. Les organisations de la société civile (OSC) et les ONG effectuent généralement des recherches avant de lancer leurs campagnes. Ces organisations peuvent non seulement être de bonnes sources, mais elles peuvent aussi mettre les journalistes en contact avec les membres de la communauté touchée par un projet ou un programme décidé par les autorités publiques, par exemple. Rien n’empêche un journaliste de s’adresser directement à une source, mais un bref mail ou un SMS qui présentera un journaliste à un agriculteur représentant sa communauté ou à un membre d’un groupe autochtone pourra aussi être très efficace. Le journaliste sera ainsi mis en relation avec la personne idoine, en particulier quand il s’agit d’un problème qui divise les membres d’une communauté. Les OSC sont depuis longtemps des sources extrêmement utiles pour les journalistes, mais la règle générale s’applique quand même : toute information obtenue par leur intermédiaire ou par tout autre source devra être vérifiée.
Conseil : Dans les juridictions ou les pays où il est difficile d’obtenir des informations, contactez les OSC ou les ONG qui ont pu être consultées par les autorités publiques sur un projet ou un programme donné. Elles pourront vous fournir des informations ou des éclairages que vous pourriez avoir du mal à obtenir en en faisant la demande auprès des autorités publiques.
Faites appel au crowdsourcing, le cas échéant. Pour les reportages qui concernent une population particulière, par exemple les travailleurs immigrés ou ceux du numérique, les communautés de motards, etc., un bon moyen d’identifier des sources consiste à rejoindre leurs groupes sur Facebook ou sur les plateformes de messagerie. Les stratégies en matière de crowdsourcing diffèrent en fonction de la nature du sujet. Quand un journaliste est limité géographiquement, c’est le crowdsourcing en ligne qui fonctionne le mieux. Les journalistes n’ont qu’à se présenter et expliquer leur objectif. Mais pour les sujets qui ont trait à la cybercriminalité, les journalistes doivent faire preuve de prudence quand ils recherchent des personnes à interviewer. Ils envisageront notamment, au début, d’utiliser des comptes fictifs pour protéger leur identité. Par exemple, les journalistes qui ont participé à une enquête collaborative transfrontalière qui a révélé des délits sexuels numériques en Asie, ont utilisé des profils d’utilisateur alternatifs pour trouver des sources et observer l’activité en ligne.
Si vous avez un besoin similaire, il peut être utile de demander au préalable son avis à votre rédacteur en chef ou à un juriste avant de créer des comptes fictifs, pour vous assurer que vous n’enfreignez pas la loi du pays concerné.
Conseil : Familiarisez-vous avec les limites du crowdsourcing. Rechercher des sources en ligne ne paie pas toujours. En effet, certaines sources n’ont plus envie de répondre dès qu’elles découvrent que vous êtes journaliste. Il est donc conseillé de combiner le crowdsourcing avec d’autres moyens pour identifier les sources utiles à votre projet.
Identifiez d’autres méthodes pour élargir votre panel de sources. L’idéal est de se constituer un réseau de sources, mais même quand l’enquête évolue très vite, les journalistes doivent s’efforcer d’identifier d’autres sources qui peuvent apporter des points de vue nouveaux et nuancés sur une question. Ne vous reposez pas sur vos sources habituelles.
A mesure que l’enquête avance, si vous prenez en compte des critères d’intégration sociale et d’égalité des sexes, vous donnerez la parole dans votre reportage à des personnes que l’on entend rarement. Par exemple, la majorité des personnes contactées pour traiter de sujets liés aux infrastructures ou aux nouvelles technologies sont des hommes. Gardez à l’esprit que l’inclusion donne de la profondeur à un reportage, peut le rendre plus complet, et peut même l’améliorer.
Prenons l’exemple d’un journaliste qui travaille sur l’émergence des “villes intelligentes” dans le Sud global, où la plupart des besoins primaires ne sont toujours pas couverts (les villes intelligentes utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour améliorer leurs infrastructures). Si vous voulez que votre reportage contribue à l’inclusion sociale et à l’égalité des sexes, vous pourriez essayer d’interviewer une ingénieure, même s’il est facile de trouver des hommes qui exercent cette profession. Les ingénieurs des deux sexes peuvent faire appel à leurs compétences, en tant qu’experts en la matière, mais il y a des problèmes qu’une ingénieure pourrait identifier immédiatement et auxquelles un ingénieur ne penserait pas forcément. Par exemple la nécessité de prévoir un plus grand espace pour les toilettes dans un endroit donné, ou d’avoir des trottoirs dignes de ce nom. Les mères d’enfants en bas âge ont besoin d’avoir accès à des toilettes suffisamment spacieuses pour pouvoir leur prodiguer des soins. De même, étant donné que, dans de nombreuses cultures, la majorité des femmes ne conduisent pas, il est important que les trottoirs soient adéquats.
Conseil : Examinez votre liste de contacts d’un œil critique et enrichissez-la. Recherchez des experts dans des groupes de la population qui sont sous-représentés.
S’informer sur les sources
Il est essentiel de s’informer sur ses sources si l’on veut réussir son interview. Une fois que vous avez une source ou que vous avez obtenu son accord pour une interview, faire des recherches à son sujet et dresser son portrait peut vous aider à élaborer votre stratégie d’interview. Dans de nombreux cas, cela vous permettra de faire le tri dans les informations fournies par votre source.
Nous vous proposons ci-dessous des outils et des conseils pour trouver des informations sur vos sources :
Allez sur le web, identifiez de multiples sources. Ici, le mot clé est ‘multiples’. On sait que ce qui est disponible en ligne n’est pas forcément exact. Par conséquent, il vaut mieux ne pas se contenter d’une seule source. Il vous faut recueillir des informations sur vos sources sur les réseaux en source ouverte, comme des articles ou autres publications sur le web, notamment les réseaux sociaux, les commentaires sur un article, ou même sur des sites moins évidents, comme les plateformes de jeux.
Cherry Salazar indique qu’elle effectue souvent des recherches booléennes sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche pour vérifier les portraits, les affiliations et les déclarations publiques des personnes qu’elle envisage d’interviewer.
“Les recherches sur les backgrounds des sources permettent d’identifier des biais potentiels ainsi que les raisons qui peuvent pousser ces sources à vous parler. Qu’ont-elles à y gagner ? Est-ce qu’elles cherchent à sensibiliser les gens à une injustice ou à profiter de cette couverture médiatique pour des raisons carriéristes ou politiques ? Ce sont là des considérations très importantes, également”, ajoute-t-elle.
Voici quelques-uns des outils que les journalistes peuvent utiliser pour trouver des informations sur leurs sources potentielles :
Whopostedwhat.com est un outil de recherche qui permet aux journalistes de rechercher sur Facebook des posts, des images et des vidéos, en fonction de la date et du sujet. Cet outil, créé par Henk van Ess, Daniel Endresz, Dan Nemec et Tormund Gerhardsen, effectue des recherches systématiques sur Facebook, qui cumule des quantités de données énormes par le biais des activités de ses utilisateurs. Il fonctionne un peu comme un filtre qui permet de savoir qui a posté quoi à propos d’un sujet ou d’un problème donné.

Image : Capture d’écran, Who posted what?
Cette application permet de rechercher un nom d’utilisateur sur près de 600 plateformes en ligne. Dans l’exemple ci-dessous, le nom d’utilisateur de l’ancien sénateur philippin Manny Pacquiao, ‘@MannyPacquiao’, apparaît sur au moins 63 sites. Utilisez cette application avec circonspection. En effet, on ne peut pas partir du principe que tous ces comptes ont à coup sûr un lien avec l’ancien boxeur professionnel, mais ils peuvent être utiles pour trouver des informations sur lui et pour identifier des connexions, au-delà de ses activités politiques ou sportives.

Image : Capture d’écran, WhatsMyName
L’organisation à but non lucratif Internet Archive a créé la Wayback Machine pour constituer une bibliothèque numérique de sites internet. Le site, créé en 1996, archive plus d’un milliard de pages web chaque jour. Cet outil est très utile quand les journalistes recherchent des informations sur une personne ou un sujet qui ont été effacées.

Image : Capture d’écran, Wayback Machine
Effectuez des recherches sur les réseaux sociaux. GIJN propose différentes ressources pour trouver des informations sur vos sources potentielles. Si vous voulez consulter un guide mis à jour récemment sur les recherches en ligne, reportez-vous au guide constitué de sept chapitres de Hank van Ess sur la manière d’utiliser Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Telegram et X pour recueillir des informations en ligne sur des personnes et sur des sujets. Hank Van Ess a aussi rédigé un chapitre sur l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et sur les meilleures pratiques d’utilisation de ces outils pour vérifier des affirmations en ligne.
Faites une demande auprès des archives publiques. L’idéal, quand on recherche des informations sur une personne, c’est de compléter sa recherche en ligne par des informations recueillies auprès d’autres personnes ou encore dans des documents non disponibles en ligne. En contactant des journalistes qui ont déjà travaillé sur votre sujet, vous pouvez par exemple obtenir des informations complémentaires sur la vie personnelle et professionnelle d’une personne, notamment sur son milieu familial, ses relations d’affaires, ses amis ou ses centres d’intérêt.
Si la nature de votre enquête s’y prête, vous pouvez faire une demande auprès des archives publiques pour dresser le portrait de la personne qui fait l’objet de votre enquête. Voici un guide de GIJN pour faire une demande en vertu du droit à l’information. Concernant les autorités publiques, les journalistes doivent au minimum pouvoir obtenir des informations sur leur déclaration de patrimoine, leur curriculum vitae, leurs affaires judiciaires et leurs rapports de financement de campagne. Si ces personnes ont des relations d’affaires, les journalistes doivent aussi avoir accès aux registres des sociétés, aux rapports de gestion et aux copies des contrats.
Concernant les personnes privées, qui possèdent une entreprise ou qui ont des relations d’affaires, certaines informations peuvent être obtenues en consultant les archives relatives aux activités de leur entreprise ou d’entités commerciales réglementées par les autorités. Il peut s’agir par exemple de licences accordées aux sociétés et de leurs dossiers d’immatriculation, de fiches d’information, de bilans financiers, de dossiers judiciaires et de listes noires. En général, on peut y avoir accès en passant par les agences de régulation des entreprises, les tribunaux ou les centrales d’achat, si de telles archives sont mises à la disposition du public.
Etablir une relation avec les sources
Le rapport que le journaliste établit avec ses sources joue un rôle déterminant dans la réussite de l’enquête. Ce rapport dépend cependant en grande partie du genre de sujet traité. La relation qu’un journaliste peut avoir avec des sources qui sont membres d’une communauté est généralement différente de celle qu’il aura avec des responsables qui peuvent être amenés à rendre des comptes.
Srishti Jaswal recommande d’utiliser un esprit de curiosité quand on recherche des sources. Elle indique que quand elle s’entretenait avec des employés du BJP dans son reportage intitulé “Inside the BJP’s WhatsApp Machine” (“A l’intérieur de la machine WhatsApp du BJP), elle ne s’est jamais rapprochée de ses sources en utilisant une posture de demande de reddition de comptes.
“J’ai toujours adopté une posture de curiosité avec ces sources. Ainsi, quand je les rencontrais, même la première fois, je leur disais que j’étais tout simplement curieuse de savoir en quoi consistait leur travail. Je n’ai jamais eu l’intention de leur faire la morale, de leur dire : ‘Vous savez, ce que vous faites est mal’. Jamais. Je n’ai jamais jugé ces sources pour le travail qu’elles faisaient”, a-t-elle ajouté.
Dans le même temps, il est impératif de traiter de manière équitable les personnes qui doivent rendre des comptes, en leur donnant amplement le temps d’exercer leur droit de réponse et en leur adressant un courrier pour les informer des révélations contenues dans votre reportage avant sa diffusion ou sa publication.
La journaliste Cherry Salazar, qui a filmé un grand nombre d’interviews, indique que l’on néglige souvent de faire en sorte que l’entretien se déroule dans un cadre où les personnes se sentiront à l’aise. Les sources qui sont disposées à vous donner des informations confidentielles ont besoin d’être dans un espace où elles se sentent en sécurité. Celles qui hésitent à l’idée d’avoir affaire à un journaliste doivent bien comprendre que l’interview est un passage obligé si elles veulent partager des informations ou répondre à des questions. Cela ne veut pas dire que l’interview doit être empreinte de condescendance, ou qu’elle ne peut pas se dérouler de façon critique. Mais vos sources doivent avoir le sentiment que vous n’avez pas d’idée préconçue à leur sujet, que vous ne leur êtes pas hostile.
“C’est aussi vrai pour les simples citoyens qui prennent le temps de vous parler d’un aspect privé de leur vie. Le fait de prendre connaissance des difficultés d’une personne [par le biais d’une interview], pour moi, est aussi une manière de témoigner. Et c’est un privilège que nous avons, en tant que journalistes. Ces personnes méritent de se sentir écoutées”, indique-t-elle.
Etudes de cas
Blind Trust, par Kateryna Rodak et Nataliya Onysko, NGL.media, mars 2023
Cette enquête, réalisée par Kateryna Rodak et Nataliya Onysko de NGL.media, a révélé des négligences médicales qui ont conduit à la cécité de 22 personnes ukrainiennes. Sur la base de plusieurs interviews, les deux journalistes ont utilisé leurs compétences professionnelles et sociales pour encourager des médecins et autres témoins à parler. Elles ont ainsi découvert que certains professionnels de santé se faisaient de l’argent en remplaçant des médicaments onéreux par des versions moins chères ou par des contrefaçons, tout en faisant payer les médicaments au prix fort aux patients.
Secret Corridors, par Joseph Poliszuk, Ma. Antonieta Segovia et María de los Ángeles Ramírez, Armando.info, janvier 2022
En 2022, le média d’investigation vénézuélien Armando.info et le journal espagnol El País ont utilisé le ‘machine learning’ pour identifier et révéler au grand jour un vaste réseau d’opérations minières illégales dans le sud du Venezuela. Leur investigation a remporté le prix Global Shining Light Awards (dans la catégorie Grands médias) lors de la 13e Conférence internationale de journalisme d’investigation qui s’est tenue en Suède en septembre 2023. L’utilisation d’outils novateurs a été mise en lumière dans cette enquête, mais le fait que Maria de los Angeles Ramirez a suivi avec beaucoup de soin la piste de différentes personnes directement sur le terrain a été tout aussi important pour la réussite du reportage. Elle a pu assurer sur le terrain le suivi des informations ou confirmer ce que l’équipe avait décelé dans la base de données numériques.
Stolen Privacy: The Rise of Image-Based Abuse in Asia, par Raquel Carvalho, South China Morning Post, mai 2023
Dans cette série de reportages, la journaliste a travaillé sur le chantage aux photos intimes dans plusieurs pays d’Asie. La journaliste Raquel Carvalho, du South China Morning Post, a trouvé le juste équilibre entre la nécessité d’obtenir des informations auprès des victimes et de les vérifier, et celle de veiller à ce que, ce faisant, ces personnes ne soient pas victimisées à nouveau.

Karol Ilagan est une journaliste philippine et une formatrice en journalisme. Avant de rejoindre la faculté de l’Université des Philippines Diliman, elle a dirigé des enquêtes et des projets collaboratifs au Philippine Center for Investigative Journalism, une organisation à but non lucratif à Manille. Elle dispense actuellement des cours de journalisme d’investigation et de journalisme de données. Elle s’intéresse en particulier aux perturbations numériques, à la pérennité des médias et à l’innovation en journalisme dans les démocraties restreintes. Karol Ilagan est membre du Consortium international de journalistes d’investigation, et elle a cété boursière des programmes Rainforest Investigations et AI Accountability du Pulitzer Center. Elle a bénéficié d’une bourse Fulbright de l’Université de Missouri Columbia.