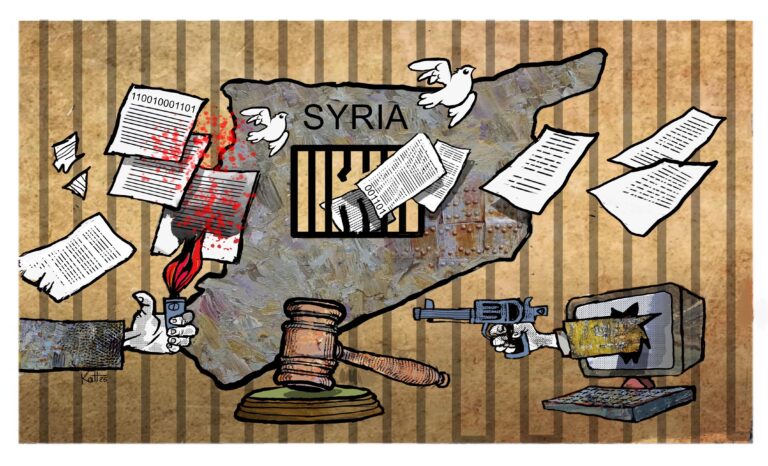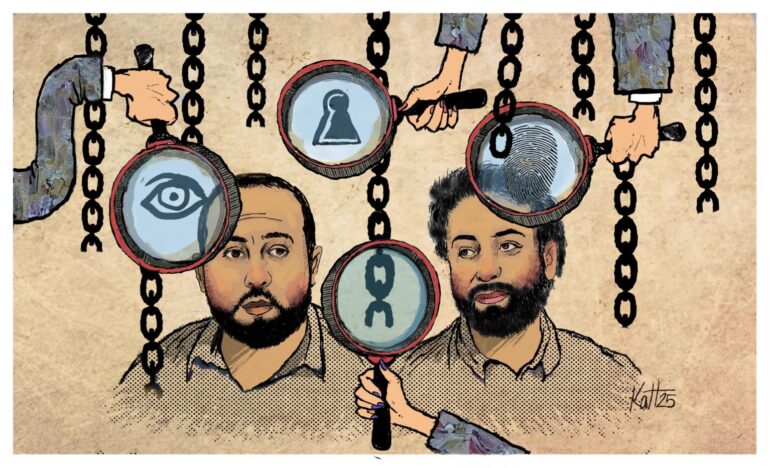Harush Ziberi, a Muslim man begs for his life from the Serbian paramilitary unit known as the Tigers and led by warlord Arkan during the first battle for the war in Bosnia. He was later thrown from a window during an interrogation and eventually found in a mass grave. Image: Ron Haviv/VII
Guide pour enquêter sur les crimes de guerre : Les attaques contre des civils

Harush Ziberi, un musulman, supplie l’unité paramilitaire serbe connue sous le nom
de Tigres de lui laisser la vie sauve, lors de la première bataille de la guerre en Bosnie
en 1992. Il a plus tard été défenestré pendant un interrogatoire, et son corps a
finalement été retrouvé dans une fosse commune.
Dans cet extrait du Guide pour enquêter sur les crimes de guerre de GIJN, des journalistes aguerris dévoilent leurs conseils et leurs outils pour couvrir les attaques contre les civils lors d’une guerre et interviewer les survivants non combattants des conflits armés.
Note de la rédaction : Cet article fait partie du Guide pour enquêter sur les crimes de guerre de GIJN dont les 16 chapitres ont été publiés en anglais à l’occasion de GIJC23. Les photos sont signées Ron Haviv et John Stanmeyer, nous les utilisons avec l’aimable autorisation de l’organisation à but non lucratif VII Foundation.
Les journalistes sont les témoins privilégiés des atrocités commises contre les civils. Sans leurs yeux et leur présence sur le terrain, la barbarie des guerres
passerait probablement inaperçue.
Déterminer qui a fait quoi à qui, où, quand et comment : ce sont les questions élémentaires que des journalistes se posent spontanément, qu’ils couvrent des conflits armés internationaux, qui impliquent plus d’un État, ou des guerres civiles. Dans les deux cas de figure, il peut y
avoir des morts et des blessés parmi les civils, des déplacements de population et la destruction d’infrastructures, médicales entre autres.
Entraver la distribution d’aide humanitaire en la pillant ou en bloquant l’accès aux zones concernées, et orchestrer des campagnes de mésinformation, qui altèrent la capacité des gens à avoir un avis éclairé, mettant ainsi leur vie en danger, peut aussi être source de grandes souffrances pour les populations civiles.
Il est néanmoins important de bien comprendre que, dans une guerre, les actes qui font du tort aux civils ou à leurs biens ne sont pas toujours illégaux. Pour déterminer si un crime de guerre ou d’autres violations du droit international ont été commis contre des civils, il est nécessaire de rassembler autant de détails que possible sur le contexte et les circonstances des faits. L’obligation qu’ont les parties en conflit de faire en permanence le distinguo entre les civils et les combattants est l’une des règles les plus fondamentales du droit humanitaire international (que l’on appelle aussi le droit des conflits armés et le droit de la guerre).
Si le fait de prendre délibérément pour cible des civils, ou des biens à caractère civil, constitue un crime de guerre, les torts infligés à des civils lors d’une attaque ne sont pas forcément illégaux si le principe de proportionnalité est respecté.
Le fait de bafouer ce principe de proportionnalité ou le principe de distinction constitue un crime de guerre. On compte, parmi les autres crimes de guerre spécifiques contre des civils :
- La torture ou les traitements inhumains
- Les expulsions ou les transferts illégaux, ou la détention illégale
- Les prises d’otage
- Les transferts de populations civiles dans des territoires occupés, ou l’expulsion de la population du territoire occupé
- Les pillages
- L’usage d’armes prohibées
- Le viol et autres violences à caractère sexuel
- L’utilisation de boucliers humains
- Le recours à la privation de nourriture comme méthode de guerre
- Le recrutement d’enfants soldats
Par exemple, dans les cas de violences à caractère sexuel ou de torture, il est évident qu’il s’agit d’actes illégaux car de tels actes sont toujours interdits, même à l’encontre des combattants. Dans d’autres cas, voici quelques-unes des questions que l’on doit se poser avant de conclure à une attaque illégale contre des civils ou des infrastructures civiles :
- La victime était-elle civile ? Est-il possible qu’elle ait participé activement aux hostilités ?
- Les infrastructures ou les biens immobiliers qui ont été détruits était-ils des objectifs civils ou militaires ? (Est-il possible qu’ils aient été utilisés à des fins militaires ?)
- Ces personnes ou ce bien ont-ils été délibérément pris pour
cible lors de l’attaque ? Ou bien les préjudices subis sont-ils la conséquence de leur proximité avec un combattant ou une cible militaire ?
Ces informations ne permettent pas toujours de conclure à l’illégalité ou non d’un acte, mais en répondant à ces questions, on trouvera peut- être des éléments de réponse.

Des Ukrainiens fuient devant l’avancée de soldats russes vers Irpin, en Ukraine, le 10
mars 2022. Image: Ron Haviv/VII
Conseils et outils
Avant de se lancer dans l’établissement des faits, l’enquête et la collecte de preuves, les journalistes doivent bien comprendre le contexte général. Rien n’est plus important que d’être parfaitement informé sur la géographie, la topographie, la population qui a fait l’objet d’attaques, leurs auteurs, la dynamique politique, culturelle et religieuse, le contexte historique du conflit et la manière dont il se déroule.
Recherches sur le contexte
Il est nécessaire de faire ces recherches détaillées avant de se lancer dans des enquêtes longues de plusieurs mois portant sur les attaques contre des civils, pour éviter que les journalistes ne soient manipulés par des versions trompeuses et par la propagande. Par ailleurs, les journalistes se sentiront ainsi plus en confiance, avant même d’arriver dans la zone de conflit.
Les groupes de réflexion constituent l’une des principales sources de documentation, comme ceux que l’on trouve dans cette liste pour le Proche-Orient et l’Afrique du nord, dressée par la George Washington University. Les centres de documentation comme International Crisis Group, le Panel d’experts de l’ONU, et des organisations de défense des droits comme Amnesty International sont toujours très utiles. Les travaux déjà effectués par des enquêteurs de l’ONU sur les droits humains sont également importants, comme ceux qui sont affiliés au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme. Comme toujours, les journalistes doivent procéder à des recherches
exhaustives à partir des travaux déjà réalisés sur le conflit en question.
Une base de données d’informations, comme LexisNexis, peut vous aider à identifier les enquêtes les plus probantes.
Ces recherches initiales doivent permettre aux journalistes de disposer d’une liste de questions : sur les personnes influentes, les profiteurs, les forces externes et internes, les lignes de front, la composition des populations affectées, les ressources en jeu, etc. Cela les orientera vers les experts à consulter. Non seulement les journalistes ont besoin de ces experts, mais les questions restées sans réponses leur seront aussi utiles, car elles leur fourniront d’autres pistes pour leurs recherches.

Plus de 600 réfugiés de la communauté rohingya, à bord d’embarcations de fortune,
traversent le fleuve Naf, pour fuir le Myanmar et atteindre l’île de Shah Porir Dwip,
au Bangladesh. Image: John Stanmeyer/VII
Interviews des témoins et des victimes
Pour prouver que des civils figurent parmi les victimes, les journalistes doivent vérifier au préalable, à partir de documents officiels, leur identité, leur niveau d’instruction et leur parcours professionnel. Les journalistes peuvent aussi recueillir des témoignages auprès des autorités municipales, des chefs coutumiers et des voisins. Les familles des victimes ont peut-être aussi des doubles de documents, comme des certificats ou des diplômes, des factures ou des reçus qui prouvent qu’un salaire était bien versé (pour les employés) ou la source de revenus (pour les chefs d’entreprise) au moment de l’attaque. Recueillir de telles preuves ou de tels témoignages, documents à l’appui, doit permettre d’apporter suffisamment d’éléments pour déterminer si la victime prenait part au conflit ou non.
En ce qui concerne les biens immobiliers ayant fait l’objet d’attaques, leur usage, civil ou non, peut être déterminé par ce que l’on appelle une liste de « cibles légitimes », dont doivent disposer les parties en conflit (en particulier si des organes gouvernementaux ou légitimes sont impliqués), liste qui comprend tous les biens immobiliers civils que les belligérants doivent éviter à tout prix. Les journalistes qui documentent les crimes de guerre doivent contacter des sources aux ministères de la défense, parfois aussi les organes concernés de l’ONU et d’autres organisations internationales, pour obtenir une copie de cette liste afin de procéder aux vérifications et d’identifier de manière certaine les sites qui n’avaient aucune valeur militaire.
Dans certaines situations, les biens immobiliers qui figurent sur la liste de cibles illégitimes peuvent être occupés ou réquisitionnés par les parties au conflit, comme des soldats ou des combattants utiliseraient des boucliers humains. Dans ces situations, les témoignages, en particulier de personnes résidant à proximité, sont fondamentaux pour déterminer si les forces militaires se trouvaient sur site au moment de l’attaque. Souvent, il arrive que des civils détiennent des vidéos d’activités suspectes dans les bâtiments près de chez eux. Cela peut se révéler utile de demander aux voisins s’ils disposent de vidéos ou de preuves visuelles pour savoir si des groupes armés utilisaient des bâtiments à des fins militaires.
Interviews d’anciens combattants ou de personnes disposant d’informations privilégiés
Dans d’autres situations, les observations de personnes disposant d’informations privilégiées, comme d’anciens membres de groupes armés ou des déserteurs, peuvent aussi être utilisées comme preuves. La priorité, dans ce genre d’enquête, est de réussir à contacter ces personnes disposant d’informations privilégiées, qui ont des liens avec une des parties en conflit, ou qui en ont une connaissance intime. Toutefois, les enquêteurs doivent faire preuve de prudence et se demander, toujours, ce qui peut motiver cette source pour accepter de vous fournir ces renseignements.
Par ailleurs, soyez bien conscient qu’il existe différents types de personnes disposant d’informations privilégiées : celles qui sont ou ont été obligées de rejoindre les auteurs d’actes délictueux contre leur gré ; celles qui estiment que le fait de coopérer présente plus d’avantages que d’inconvénients ; et celles qui ont participé de leur plein gré, et s’en sont ensuite repenties.
Vous pourriez poser les questions suivantes à ces personnes disposant d’informations privilégiées : qu’est-ce qui a motivé une attaque ou un acte donnés, et quelle en était l’intention ? Par exemple, visaient-ils un combattant ou un objectif militaire dans cette zone, ou avaient-ils pour objectif des civils et leurs biens ? Il est aussi important d’essayer d’établir de quelles informations les parties en conflit disposaient au moment de l’attaque, par exemple de renseignements sur la nature du bâtiment ou la présence de combattants dans la zone concernée. Étaient-ils conscients de la présence de civils ou de bâtiments civils ? Ces deux éléments, l’intention et les informations dont disposaient les parties en conflit, sont essentiels pour savoir si certains actes commis lors d’un conflit armé sont légaux. Ils peuvent permettre d’établir ou de réfuter l’existence de crimes de guerre contre des civils.
Franchir la barrière de la langue
La langue peut constituer un obstacle majeur pour les journalistes qui travaillent à l’international. Il est indispensable de prendre le temps de trouver un interprète fiable, indépendant et qui a fait ses preuves, de faire cet effort et d’y consacrer un budget spécifique. Il est également important de faire appel à un collègue ou à un enquêteur indépendant qui puisse vérifier la qualité du travail de cet interprète. Les journalistes doivent aussi s’assurer que les interprètes font preuve d’impartialité. Poser la même question plusieurs fois mais de différentes manières, comme le font un grand nombre de journalistes, permet de vérifier la qualité d’une traduction.
Comment se préparer à des conversations traumatisantes
Les témoignages de civils sont la pierre angulaire de toute enquête sur le bilan humain d’une guerre. Soyez bien préparé, car ces civils peuvent être gravement affectés par la mort d’un membre de leur famille, par des blessures, différents types d’agression comme un viol, un trauma psychologique, le déplacement ou la perte de leurs biens. Il arrive que les journalistes soient bouleversés par cette tâche, qui consiste à écouter des personnes brisées raconter ce qui leur est arrivé, car ils craignent de les traumatiser à nouveau.
Souvent, les victimes ou les témoins ne se livrent qu’après la deuxième ou la troisième interview. Les journalistes doivent certes recueillir autant de témoignages que possible, mais il peut être difficile d’interviewer plusieurs fois la même personne. Toutefois, les journalistes peuvent réaliser des interviews initiales avec les victimes pour identifier celles qui ont été des témoins directs ou les plus affectés, ou encore par exemple parce que ces victimes ont des proches ou des amis qui soutiennent des camps opposés et qui peuvent apporter d’autres d’informations privilégiées sur les attaques.
Établir une chronologie des faits aide aussi les journalistes à comprendre la séquence des événements et à les conduire à d’autres questions. Les réponses permettront éventuellement de combler certaines lacunes. Il est essentiel de dresser des listes de noms, de contacts et de photos des personnes interviewées.

Sifa Muhima, une thérapeute de 47 ans (à droite), auprès d’une victime de viol, dans
une maison d’écoute en République démocratique du Congo. Ces maisons proposent
une aide médicale et une thérapie de soutien aux victimes de viol. Image: Ron Haviv/VII
Les smartphones, de véritables mines d’or
Les smartphones représentent une source de données extrêmement utile pour les journalistes, et il est indispensable d’essayer d’avoir accès au téléphone d’une victime ou d’un témoin. Une fois que les victimes commencent à s’ouvrir et à parler de ce qu’elles ont vécu, les journalistes doivent toujours leur demander de leur montrer tout ce qui peut étayer leur récit. Des discussions sur les réseaux sociaux, comme WhatsApp ou Telegram, peuvent témoigner des derniers instants d’une conversation avant une agression. Elles peuvent aussi apporter des éléments décisifs : avec qui la victime communiquait-elle ? Sur quoi portaient les discussions ? Ses déplacements, ses actions et tout autre facteur peuvent aussi apporter la preuve qu’elle a bien été victime d’une agression dans le cadre d’un conflit armé.
Par ailleurs, les journalistes peuvent demander aux victimes si elles consentent à partager des captures d’écran, des photos ou des vidéos stockées sur leur téléphone, ainsi que les coordonnées d’autres victimes ou de sources qui pourraient détenir des informations privilégiées ou des documents nécessaires à l’enquête. Il est important de vérifier les dates et les lieux, et de poser des questions sur le contexte des photos pour pouvoir faire des recoupements avec les dates et les lieux identifiés par l’enquête. Les reporters doivent toujours avoir sur eux des formulaires de consentement par écrit, pour que les personnes en possession de ces informations puissent autoriser les journalistes à les publier.
Recueillir des preuves concrètes et du matériel militaire
Comme beaucoup d’activistes et d’experts des droits humains le font depuis quelques décennies, il est indispensable de recueillir des éclats d’obus, des restes d’engins explosifs et autres éléments qui prouvent qu’il a été fait usage d’armes, afin de vérifier les informations élémentaires sur une attaque donnée. La marque ou toute inscription sur ces vestiges trouvés sur le champ de bataille peut être examinée ensuite par des experts pour en déterminer l’origine.
Ces preuves ouvrent la voie à de futures enquêtes pour savoir de quels pays proviennent ces armes. En plus des victimes et des personnes disposant d’informations privilégiées, essayez de contacter d’autres sources : humanitaires, juristes, équipes médicales, chefs coutumiers, autorités locales, chauffeurs et enseignants. Tous peuvent approfondir les questions que vous vous posez et conduire à de nouvelles enquêtes.
Il est important d’obtenir les coordonnées géographiques, les noms de lieux, les cartes et les plans, ainsi que les descriptions précises des sites où ont eu lieu des attaques contre des civils. Cela vous permettra de procéder à des vérifications grâce aux images satellite et autres techniques de géolocalisation.
Études de cas
Yémen : des attaques de drones américains tuent des civils — Associated Press
Que faut-il pour prouver que la victime d’une frappe de drone américain est un civil et non un membre d’al-Qaida ? Des centaines de documents, de photos, de messages sur les réseaux sociaux et de pièces d’identité. C’est précisément ce qu’a recueilli l’équipe de l’agence Associated Press (AP) au Yémen en 2018 pour prouver que, contrairement à ce qu’affirmaient les forces armées américaines, leurs frappes aériennes n’avaient pas tué uniquement des membres d’al-Qaida dans la région.
En fait, leur enquête, qui a été récompensée par le prix Pulitzer, a révélé qu’un tiers environ des victimes des attaques de drones cette année-là étaient des civils.

Une enquête d’AP qui a duré des mois, en 2018, a prouvé que, contrairement à ce
qu’affirmaient les forces armées américaines, leurs attaques de drones n’avaient pas
tué uniquement des membres d’al-Qaida au Yémen. En fait, AP a révélé qu’un tiers
des victimes de l’ensemble des attaques aériennes étaient des civils. Image: Screenshot, Associated Press
Cette enquête longue de plusieurs mois s’est appuyée sur des données en libre accès d’organisations comme The Bureau of Investigative Journalism et Amnesty International, et sur des listes recensant les attaques aériennes menées par les Etats-Unis au Yémen, communiquées à AP par le Pentagone.
Toutefois, aucune de ces sources n’a pu livrer d’indications concernant le nombre de victimes civiles. Aucune n’a confirmé, non plus, qu’il y avait eu des victimes en raison de la pression internationale exercée sur la coalition dirigée par l’Arabie saoudite, qui menait alors une guerre sanglante contre les rebelles houthis soutenus par l’Iran. Pratiquement aucun média n’a fait état des frappes de drones américains, et l’attention des médias internationaux s’est concentrée exclusivement sur les atrocités commises par les Saoudiens.
L’enquête a été réalisée sur une grande zone incluant le sud, l’est et le centre du Yémen, où l’organisation al-Qaida était active et où les drones étaient déployés.
La première étape a consisté à recueillir toutes les dates et toutes les cibles des frappes, fournies par une source au Pentagone. Ensuite, tous les incidents ont été vérifiés et une liste des zones touchées par les frappes a été établie. De même, des activistes des droits humains, des médecins, chefs coutumiers, membres des services de sécurité et des autorités des zones prises pour cible ont été identifiés.
La troisième étape a été de réaliser des interviews approfondies avec les proches des victimes pour dresser leur portrait et prouver qu’il s’agissait bien de civils, sans lien quelconque avec le terrorisme. Le but, en faisant ces interviews, était de répondre à ces questions fondamentales : à quelle distance de la cible de l’attaque les victimes se trouvaient-elles ? Pourquoi étaient-elles à cet endroit précis ? Qui a été témoin de la frappe aérienne ? Y avait-il des indices ou des signes de la présence de membres d’al-Qaida à proximité ?
Les familles des victimes ont appelé en vain les organisations de défense des droits humains et le Comité international de la Croix-Rouge à diligenter une enquête plus approfondie sur ces attaques de drones.
Birmanie : potentiel génocide contre les Rohingyas — Reuters
L’agence Reuters a publié en février 2018 une enquête de grande qualité, où elle a révélé les violences contre les Rohingyas et les massacres de membres de cette communauté, dans un reportage intitulé How Myanmar Forces Burned, Looted, and Killed in a Remote Village [Comment les forces birmanes ont brûlé, pillé et tué dans un village isolé]. Ce reportage a remporté le prix Pulitzer du reportage international à New York en 2019. Il avait conduit à l’arrestation et à l’incarcération de deux journalistes de Reuters en décembre 2017. (Les deux hommes ont finalement été libérés en 2019 après avoir passé plus de 500 jours en prison.)
L’enquête a porté sur un village de l’Etat de Rakhine, dans le nord, en proie aux violences ethniques. C’était la première fois que le massacre était reconstitué à partir des récits de ses auteurs. Auparavant, la couverture du génocide en Birmanie reposait uniquement sur les témoignages des victimes rescapées des crimes commis contre la minorité rohingya.
Fait remarquable, l’agence Reuters a réussi à rencontrer des sources disposant d’informations privilégiées. Des villageois bouddhistes, ainsi que des membres de la police paramilitaire et des forces de sécurité qui avaient participé aux tueries, ont accepté de parler aux journalistes. En utilisant des photos du massacre, Reuters a pu obtenir des preuves incontestables.
Dans leur reportage, les journalistes faisaient remarquer que les trois photos fournies par un villageois bouddhiste “ ont immortalisé des moments cruciaux de la tuerie commise à Inn Din , depuis la détention d’hommes de la communauté rohingya par des soldats, en début de soirée, le 1 er septembre, jusqu’à leur exécution, peu après 10 heures du matin, le 2 septembre.” Sur d’autres photos, on voyait les prisonniers en rang et les corps d’autres hommes dans une fosse.
Le fait que les journalistes se rendent sur site, qu’ils y prennent des photos et les soumettent à des experts en médecine légale a aussi été un élément clé de l’enquête. Tous les experts “ont dit avoir constaté la présence de restes humains”.
Les forces armées birmanes ont déclaré à Reuters que leur « opération de nettoyage” dans la région était légitime, mais les journalistes ajoutaient dans leur reportage que “les Nations Unies ont estimé que l’armée avait peut-être commis un génocide ; les Etats-Unis ont qualifié cette opération de nettoyage ethnique”.
Ukraine : siège russe à Marioupol — Associated Press
Les reporters d’Associated Press qui ont réalisé des reportages visuels révélateurs du siège russe intitulé 20 Days in Mariupol [20 Jours à Marioupol], étaient les seuls journalistes internationaux à être restés dans cette ville d’Ukraine à la mi-mars 2022. Ils ont passé des semaines à documenter les attaques russes contre des civils, attaques qui, selon certains observateurs, pourraient constituer des crimes de guerre – les forces russes avaient isolé la ville du monde extérieur, réduisant de fait les médias au silence. Après trois semaines passées dans la ville assiégée, l’équipe d’AP a dû être évacuée d’urgence de Marioupol, après avoir appris auprès de certaines sources que les soldats russes étaient à sa recherche.
Le travail fondamental d’AP a aussi révélé au grand jour les campagnes de désinformation du gouvernement russe, en livrant un récit de première main des attaques commises contre les civils. Des images vidéo choquantes filmées par AP, montrant l’attaque d’une maternité et une femme enceinte sortant précipitamment du bâtiment, ont alors fait dire à l’ambassade de Russie à Londres que ces photos étaient truquées. Pour contrer la propagande, les reporters d’AP sont retournés dans le quartier, ont retrouvé la femme en question et ont prouvé qu’elle était enceinte au moment des faits, parce qu’elle avait depuis donné naissance à son enfant.
“Sans ces informations recueillies sur place, sans les photos de bâtiments démolis et d’enfants mourants, les forces russes auraient pu faire tout ce qu’elles voulaient. Si nous n’avions pas été là, il ne resterait plus rien”, a déclaré Mstyslav Chernov, le JRI d’AP. Avec ses collègues, il a remporté le prix du public au festival Sundance [le principal festival de cinéma indépendant aux Etats-Unis], grâce au documentaire de 90 minutes réalisé à partir de leurs reportages. “Je n’avais jamais, au grand jamais, eu le sentiment qu’il était si important de briser le silence”, a-t-il ajouté.
Palestine : la mise à mort d’une journaliste — The New York Times
Après la mort par balle de Shireen Abu Akleh, la correspondante palestino-américaine d’Al Jazeera en Cisjordanie, plusieurs organes de presse ont enquêté pour comprendre ce qu’il s’était réellement passé.
Le New York Times est l’un des organes de presse qui ne se sont pas contentés de recueillir les déclarations officielles et les témoignages, notamment auprès des collègues de Shireen Abu Akleh qui se trouvaient sur place. Fait remarquable, l’équipe a aussi procédé à des interprétations médico-légales détaillées à partir de vidéos publiées sur TikTok et d’autres réseaux sociaux, afin de reconstituer les faits.
Le New York Times a conclu que Shireen Abu Akleh avait été tuée par une balle tirée de l’endroit où se trouvait, au même moment, un convoi israélien, qui faisait une descente dans un camp de réfugiés voisin de Jénine. “Très probablement par un tireur d’élite”, selon les conclusions de l’enquête. Cette enquête a aussi exclu la théorie, avancée au départ par les autorités israéliennes, qui soutenait que des hommes armés palestiniens avaient tiré, ce qui était impossible, étant donné la distance entre ces hommes et l’endroit où se trouvait la journaliste.
L’un des outils les plus importants pour l’enquête du New York Times : l’analyse audio des coups feu enregistrés dans les vidéos publiées sur les réseaux. “En comptant les microsecondes qui se sont écoulées entre le moment où chaque balle est sortie du canon du fusil et celui où elle est passée devant les micros de la caméra, ils ont pu calculer la distance entre le fusil et les micros”, a expliqué le New York Times. “Ils ont aussi tenu compte de la température qu’il faisait ce matin-là, et des types de balle qu’utilisent généralement les Israéliens et les Palestiniens”.
Focus sur : Les victimes civiles des attaques de drones de l’armée américaine
À partir d’une interview d’Azmat Khan réalisée par Olivier Holmey
Lorsque, début 2018, Azmat Khan s’est rendu dans l’ouest de Mossoul, en Irak, les destructions étaient si importantes que tous les habitants avaient déménagé – et le journaliste n’a trouvé que peu de personnes à interviewer. Ce n’est que lors de visites ultérieures, une fois qu’une partie de la population était revenue, qu’Azmat Khan a pu recueillir des témoignages qui ont permis d’établir que les attaques de drones avaient tué des civils dans la région en plus grand nombre que ce que la coalition dirigée par les États-Unis qui combat l’organisation État islamique (EI) avait affirmé.
Azmat Khan est un membre de l’équipe d’investigation visuelle du New York Times, lauréat du prix Pulitzer. Elle a mené des enquêtes approfondies sur les victimes civiles de la guerre à distance menée par les États-Unis en Irak, en Syrie et en Afghanistan, notamment dans le cadre de deux enquêtes du New York Times, The Uncounted (Les inconnus) et The Civilian Casualty Files (Les dossiers des victimes civiles). Les reportages sur le terrain sont au cœur de son travail et nécessitent généralement de nombreuses visites.
Azmat Khan s’est également appuyée sur des dossiers militaires américains classifiés et sur des outils de reportage en open source. Nous pouvons faire certaines choses à distance », dit-elle, « mais je pense que le fait d’aller sur le terrain vous permet d’atteindre un niveau d’investigation plus élevé ». Trop souvent, le reportage à distance peut aplatir les gens ».
Pour s’assurer que les personnes qu’elle rencontre répondent à ses questions aussi franchement que possible, Azmat Khan explique qu’elle ne prévient pas à l’avance de ses visites. Elle évite également de poser des questions trop directives.
À une occasion, un témoin oculaire a spontanément mentionné le fait qu’un homme en fauteuil roulant se trouvait dans une maison frappée, ce qui correspondait à un élément d’information apparu au cours de ses recherches, confirmant ainsi sa fiabilité en tant que personne interrogée.
Azmat Khan s’est appuyée sur diverses sources, parfois improbables. Elle explique que les vidéos de propagande de l’EI se sont révélées étonnamment fiables en ce qui concerne les images de victimes civiles. Par ailleurs, les messages du gouvernement américain sur YouTube concernant les frappes aériennes de la coalition l’ont aidée à dater et à géolocaliser des attaques que les États-Unis niaient simultanément. En Irak, elle a pu consulter les certificats de décès pour confirmer les pertes. En revanche, dans les régions reculées d’Afghanistan, elle a dû étudier les pierres tombales, car les avis de décès officiels n’étaient pas disponibles.
Déterminer qui est considéré comme un civil parmi les victimes peut s’avérer délicat, note-t-elle. Sa propre définition n’inclut pas les membres de la famille des combattants de l’EI – une décision qu’elle a prise parce qu’elle n’était pas en mesure de recueillir des informations sur ces personnes, mais qui, elle le reconnaît, signifie probablement qu’elle a sous-estimé le nombre de victimes civiles.
 Maggie Michael est une journaliste d’investigation de l’agence Reuters, au Caire. Elle couvre les conflits au Proche-Orient depuis plus de 15 ans. En 2019, elle faisait partie de l’équipe d’Associated Press qui a remporté plusieurs prix, notamment le prix Pulitzer du reportage international et la Médaille McGill du Courage pour des enquêtes novatrices sur la corruption, latorture, et les crimes de guerre au Yémen.
Maggie Michael est une journaliste d’investigation de l’agence Reuters, au Caire. Elle couvre les conflits au Proche-Orient depuis plus de 15 ans. En 2019, elle faisait partie de l’équipe d’Associated Press qui a remporté plusieurs prix, notamment le prix Pulitzer du reportage international et la Médaille McGill du Courage pour des enquêtes novatrices sur la corruption, latorture, et les crimes de guerre au Yémen.
 on Haviv est un réalisateur dont le travail a été sélectionné aux Emmy Awards et un photojournaliste primé. Il est aussi le cofondateur de l’agence de photos VII, spécialisée dans la couverture des conflits et dans la sensibilisation aux questions des droits humains dans le monde, et le cofondateur de la fondation à but non lucratif, VII Foundation, qui se focalise sur des projets documentaires et propose des formations gratuites au journalisme visuel.
on Haviv est un réalisateur dont le travail a été sélectionné aux Emmy Awards et un photojournaliste primé. Il est aussi le cofondateur de l’agence de photos VII, spécialisée dans la couverture des conflits et dans la sensibilisation aux questions des droits humains dans le monde, et le cofondateur de la fondation à but non lucratif, VII Foundation, qui se focalise sur des projets documentaires et propose des formations gratuites au journalisme visuel.