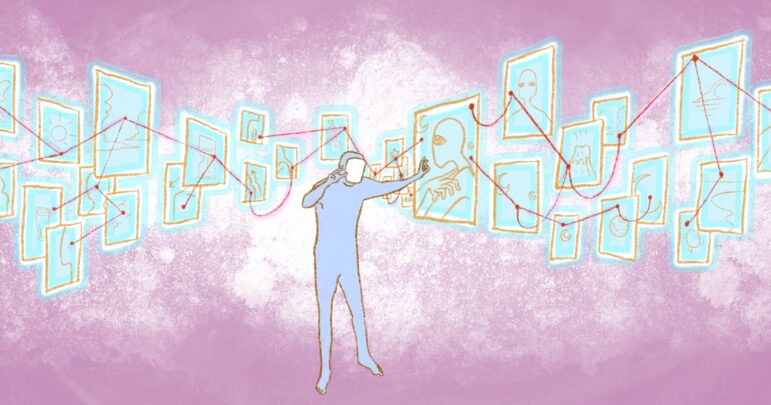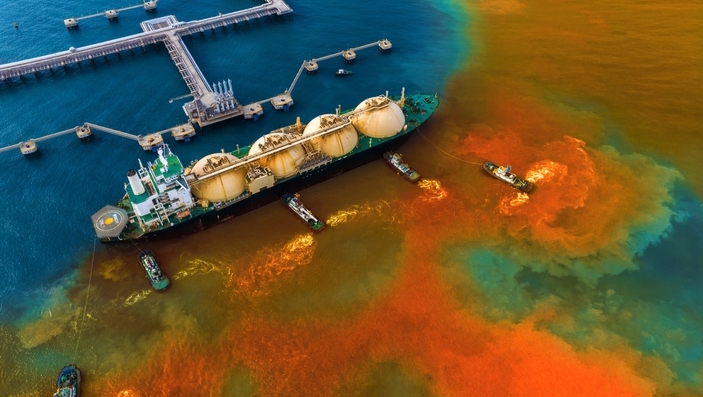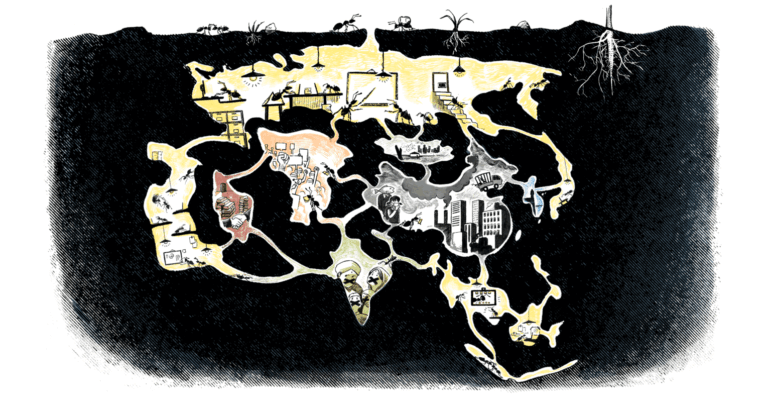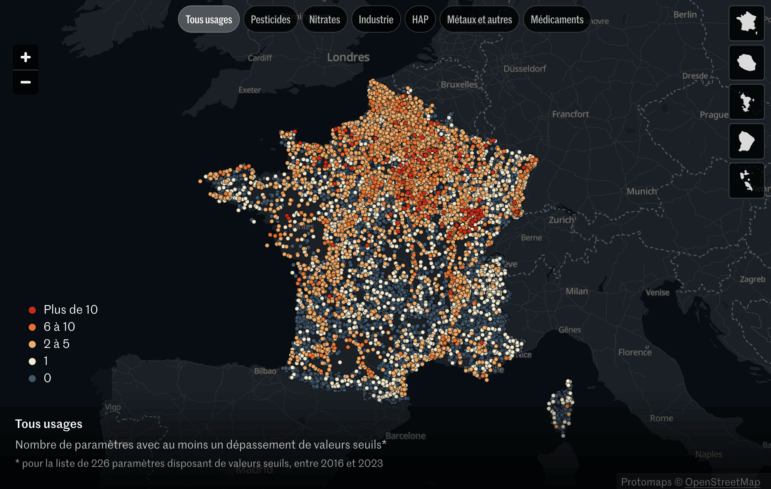Screenshot
Guide pour enquêter sur les crimes de guerre : comment prendre soin de soi quand on couvre des événements traumatisants
Lire cet article en
Il n’est pas du tout dans l’intérêt des criminels de guerre que les journalistes qui enquêtent sur eux se préoccupent de leur propre bien-être. En effet, ils préfèrent de loin que les journalistes soient bouleversés, en burnout, qu’ils négligent la tenue de leurs dossiers et perdent de vue l’importance de leur travail.
Faire preuve de résilience ne veut pas dire que l’on ne souffre pas d’anxiété. Il s’agit de savoir comment la gérer.
Continuer à se prendre en charge, de manière systématique, et encourager ses collègues à faire de même, est une condition essentielle pour contrer la cruauté humaine.
Trauma indirect
Parfois, les risques de trauma sont liés à la présence des journalistes sur les lieux mêmes où se déroulent des violences. Mais le plus souvent, les problèmes se posent de manière plus indirecte, quand on est confronté à de nombreux détails traumatisants, et ce de manière répétée. Par exemple quand on :
- Interagit de façon étroite avec des personnes qui ont subi un traumatisme (interviews) ;
- Visionne des photos explicites de violences ;
- Travaille sur des témoignages perturbants (transcriptions et enregistrements).
La notion de trauma indirect implique qu’on peut être affecté par des violences ou des abus, même si ceux-ci ne nous ont pas atteint directement. (Les attaques de trolls et autres menaces sont des problèmes distincts, mais liés.)
Réactions et réponses
Commençons par une bonne nouvelle. Certaines compétences liées à votre travail vous protégeront. Le sentiment très fort d’avoir une mission personnelle à accomplir, le détachement professionnel, le fait de pouvoir considérer les problèmes sous différents angles et de travailler avec des équipes compréhensives, contribuent à la résilience des journalistes.
Néanmoins, quand vous êtes exposé à des niveaux élevés de trauma indirect, les symptômes suivants peuvent apparaître :
- Difficulté de concentration
- Irritabilité
- Troubles physiologiques (tension musculaire, problèmes liés au sommeil et à la digestion, système immunitaire affaibli, etc.)
- Troubles de l’humeur, avec une plus grande propension aux pensées négatives
- Les sujets traités dans le cadre de votre travail s’immiscent dans votre vie, dans votre façon de voir les choses
- Vous avez du mal à faire confiance aux gens, à vous lier
- Vous avez un sentiment de culpabilité ou de honte
- Vous êtes exténué
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ces réactions à l’anxiété ne signifient pas nécessairement qu’il y ait un quelconque préjudice affectif sur le long terme.
Tous les symptômes cités ci-dessus sont des conséquences normales des réactions de survie qui se manifestent quand notre corps anticipe l’éventualité de violences, même si ces elles sont désagréables et ne sont pas les bienvenues.
Généralement, les réactions au trauma, complexes, se résorbent d’elles-mêmes, une fois que l’on cesse d’être exposé, par exemple à de nombreux documents perturbants, et que la connexion entre le corps et le mental dispose de la latitude nécessaire pour revenir à un état de stimulation moindre. Cela peut prendre des jours, voire plusieurs mois.
Il est important de noter que pendant une crise, notamment quand on vit et qu’on travaille dans une zone de guerre, il est probable que la réaction dure plus longtemps, pendant que le conflit se poursuit ou si l’on voit en permanence des choses qui nous rappellent le conflit une fois qu’il est terminé.
Si l’on prend l’exemple d’une situation actuelle, la guerre que mène la Russie en Ukraine, les journalistes qui font des reportages près des lignes de front constateront peut-être que leur stress diminue une fois qu’ils sont de retour dans une région plus sûre du pays. Mais il est peu probable que leur stress retrouve son niveau initial aussi longtemps que la guerre se poursuivra.

Un cameraman en train de filmer une maison détruite à Dnipro, en Ukraine, après une frappe de missile russe. Même après avoir quitté les lignes de front et être revenus dans un endroit plus sûr, les reporters de guerre peuvent quand même ressentir un stress plus élevé que la moyenne.
Il est naturel et prévisible qu’un impact se fasse sentir, mais cela ne signifie pas qu’il ne faut pas s’en préoccuper et le gérer. Les réactions citées plus haut perturbent le travail et la vie des journalistes et, si elles ne sont pas prises en compte, elles peuvent engendrer des problèmes à plus long terme.
Les choses qui peuvent améliorer la situation ? Prendre conscience de ce qui se passe (grâce à la psychopédagogie), bénéficier d’un soutien social et se prendre en charge.
Dans certaines situations, la question d’un soutien clinique peut se poser. Certains journalistes estiment que la psychothérapie est bénéfique pour gérer les problèmes personnels ou liés au travail. C’est le contexte qui dicte à quel moment il est conseillé (et pas facultatif) de demander de l’aide.
En situation de guerre, comme on l’a vu plus haut, on a tendance à réagir davantage. Il n’est pas rare que des journalistes aient le sentiment de vivre sur le fil du rasoir ou d’être comme anesthésiés. Un soutien clinique individuel est recommandé quand un journaliste ou un membre de l’équipe est en crise et a de gros problèmes pour vivre au quotidien, pour gérer ses émotions et pour effectuer des tâches simples. (Les premiers secours psychiques peuvent être utiles si vous êtes en contact avec un collègue en difficulté.)
La situation est différente quand la guerre est terminée, ou que le journaliste a quitté la zone de guerre et est revenu dans un pays en paix. Mais des difficultés inhabituelles qui persistent pendant de longues périodes, malgré le fait que la personne se prend en charge, par exemple si elle est irrémédiablement triste, incapable de ressentir quoi que ce soit ou qu’elle a un sentiment de colère, l’aide d’un thérapeute spécialisé peut être indiquée. Le burnout, la dépression et les troubles de stress post-traumatique (TSPT) sont des conséquences possibles quand on est continuellement exposé à un trauma indirect.
Avec le temps, la plupart des gens se remettent de leurs expériences traumatiques. Ils n’oublient pas, mais leurs souvenirs deviennent plus faciles à gérer.
Il n’y a pas de recette miracle pour se sentir bien et être en bonne santé psychique. Si vous traversez une mauvaise période et que vous vous demandez si vous allez vous en sortir, il est important de demander de l’aide.
Ressentir la douleur des gens
Certains journalistes ne tiennent pas compte de l’impact que leur travail peut avoir sur eux parce que cela leur parait trivial en comparaison avec ce que vivent les personnes qu’ils interviewent. C’est compréhensible, mais c’est mal comprendre ce qui est en jeu.
Pour réaliser de bonnes interviews, il faut pouvoir faire preuve d’empathie, voir les choses du point de vue des gens. Mais établir une connexion au point de ressentir les émotions d’une autre personne peut aussi vouloir dire que l’on partage certaines de ses préoccupations. Un journaliste peut ressentir, inconsciemment, de l’impuissance, de la culpabilité ou de la honte, comme certaines des personnes qu’il interroge.
Peu à peu, ces impacts s’accumulent. Le journaliste peut devenir blasé et insensible à la détresse d’autrui, ce qui peut être un vrai problème quand il interviewe des personnes vulnérables. On parle parfois de ‘compassion fatigue’ en anglais, mais c’est davantage une question d’empathie que de compassion.
On ne peut pas passer tout son temps à travailler sur des images traumatisantes ou à voir des événements traumatisants à travers un témoignage. Nous devons pouvoir nous détacher, tout en établissant une relation avec les gens.
Ce qui peut aider
- Faites attention à ne pas trop vous exposer
L’empathie est comme un muscle : elle est essentielle pour faire du bon travail, mais elle ne se renforce qu’après un repos adéquat. De plus, les enquêtes ressemblent souvent davantage à un marathon plutôt qu’à un sprint.
Par conséquent :
- Espacez les interviews. N’en faites pas trop à la suite.
- Travaillez sur les documents les plus pénibles quand vous êtes frais et dispos. Il est plus difficile de gérer son anxiété quand on est fatigué.
- Evitez de vous exposer à nouveau si vous le pouvez. Un guide du Dart Center propose des tactiques plus spécifiques pour travailler sur des images traumatisantes que l’on peut aussi appliquer à des textes.
- Faites des pauses de façon régulière. Essayez de temps en temps de vous concentrer sur des aspects moins pénibles de votre reportage ou sur autre chose. (Si vous êtes assis, levez-vous et bougez.)
- Ne passez pas tout votre temps sur votre ordinateur ou votre téléphone. En tant que journaliste, vous êtes déjà exposé à l’actualité pendant votre temps de travail. Si quelque chose vous rappelle votre travail, votre stress peut augmenter et perturber votre sommeil.
2. Soyez à l’écoute de votre corps
Chacun de nous sait reconnaître les signes de fatigue : des muscles tendus, des maux de gorge, une irritabilité inhabituelle ou des accès soudains d’autocritique. C’est le moment de vous ressourcer.
Un journaliste efficace est un journaliste bien reposé.
3. Ayez pour objectif de vivre avec votre anxiété, plutôt que l’éliminer
Cela peut sembler paradoxal, mais gérer son anxiété ne veut pas dire que l’on bannit ses pensées et ses émotions désagréables. Ce n’est pas réaliste, au quotidien, et encore moins quand on travaille sur des crimes de guerre.
Essayez plutôt de les atténuer, pour qu’elles masquent moins les côtés positifs de la vie. Le fait d’identifier ce qui est en train de se passer peut aider à lutter contre l’anxiété et à vous redonner le sentiment de maîtriser la situation. Lutter contre un mal-être peut l’intensifier.
- Continuez à vous prendre en charge
Chacun d’entre nous sait comment recharger ses batteries. Le plus dur, c’est de le faire de manière régulière, surtout quand on travaille sur un projet qui est urgent et très prenant.
Soyez conscient que des quantités de contenus négatifs peuvent prendre toute la place, au détriment des choses positives. On finit par travailler trop et on a plus de mal à se concentrer sur des activités réparatrices.
Des petits rituels peuvent vous aider et sont faciles à respecter : 10 minutes d’exercice par jour auront davantage d’impact que deux heures un weekend sur deux.
Une autre méthode consiste à se poser de manière régulière (chaque jour, au besoin) trois questions qui ont trait au corps, au mental et à l’esprit.
Corps : comment est-ce que je prends soin de mon bien-être physique ?
Commencez par là. Le corps est source de tension. De l’exercice, une bonne hydratation, un régime alimentaire nutritif et un sommeil de bonne qualité permettent de lutter contre le stress. Rappel :
- Même un exercice physique modéré (étirements, marche, danse, etc.) peut vous aider à avoir meilleur moral ou à retrouver un équilibre.
- Envisagez de maîtriser une technique de régulation du stress, comme la respiration diaphragmatique profonde ou la relaxation musculaire progressive. (On les enseigne de manière systématique aux soldats et aux secouristes qui opèrent en milieu très stressant.)
- Le sommeil est important. Tapez “hygiène du sommeil” dans Google. (Hélas, l’alcool ne nous aide pas à dormir : il nuit à la qualité du sommeil même en petites quantités.)
Mental : comment j’aborde les problèmes
La manière dont nous abordons nos problèmes joue un rôle important. Quand on travaille sur un trauma, il faut essayer de se détacher pour n’être impliqué qu’à moitié, plutôt que d’avoir des idées fixes. (Certaines personnes trouvent que la pleine conscience les aide.) Posez-vous de temps en temps les questions suivantes :
- Est-ce que je n’essaie pas d’en faire trop ?
- Est-ce que je me sens coupable pour des choses sur lesquelles je n’ai pas de prise ?
- Est-ce que je m’identifie de manière particulièrement forte à une personne que j’ai interviewée ?
Si vous répondez par l’affirmative à l’une de ces trois questions, prenez le temps d’analyser la situation, si possible avec des amis, ou avec des collègues en qui vous avez confiance. Adoptez la même approche si vous êtes face à un dilemme déontologique ou si vous ne parvenez pas à choisir l’angle d’un reportage. Vous trouverez aussi peut-être utile de tenir un journal ou de vous tourner vers l’écriture créative pour gérer ces problèmes.

Journaling and other forms of creative writing can be an effective way to deal with stress and trauma. Image: Shutterstock
Esprit : qu’est-ce que je fais pour gérer des choses qui semblent me dépasser ?
Esprit, âme, transcendance. Quel que soit le mot que l’on emploie pour parler de cette dimension, quand on travaille sur un trauma, l’espace se rétrécit, et on peut facilement se détacher de ses valeurs et de ses relations.
Le troisième niveau consiste à faire des choses qui nous permettent de rester en phase avec les choses de la vie et leur signification.
De nombreux travaux de recherches montrent que l’interaction avec nos proches et l’attachement à certaines valeurs et au sentiment d’être utile, qui fait que nous nous dépassons, sont étroitement associés à la résilience.
Pour les journalistes, certains de ces bénéfices sont dus au travail lui-même, à l’importance qu’ils accordent à leur mission en tant que journalistes, et à la déontologie. Mais l’idéal est de trouver un équilibre avec sa vie personnelle. Voici quelques exemples d’activités qui peuvent être bénéfiques :
- Passer du temps dans la nature
- Assister à des événements/manifestations qui peuvent susciter l’émerveillement (concerts, événements sportifs, religieux ou spirituels, etc.)
- Créativité (art, jouer de la musique, faire du jardinage, etc.)
- Faire preuve de bienveillance à l’égard d’inconnus
- Activités caritatives et bénévolat
- Entretenir nos relations personnelles et nos amitiés
- Souciez-vous du bien-être d’autrui
Comme les paragraphes ci-dessus le laissent penser, il ne s’agit pas ici uniquement de se prendre en charge, mais aussi de se préoccuper du bien-être d’autrui, de veiller les uns sur les autres. Nous serons plus enclins à prendre soin de nous si ceux qui nous entourent nous y encouragent et font de même.
N’oubliez pas : les personnes exposées à un trauma peuvent se sentir isolées de leurs collègues. Il s’agit d’un processus dynamique, qui implique un suivi et des efforts constants. Il revient à la direction et aux responsables de la rédaction de guider ces efforts, mais chaque journaliste a aussi un rôle à jouer en s’assurant que ses collègues ont le sentiment d’être soutenus. La solidarité au sein d’une équipe est aussi un moyen très efficace pour contrer les menaces extérieures.
Traduit de l’anglais par Béatrice Murail.
Ressources complémentaires :
Guide to Handling Vicarious Trauma
Approches de la gestion du trauma dans différentes professions : Personnel de santé, Avocats des droits humains, et Personnes au contact des victimes de crimes.
 Gavin Rees est conseiller au Dart Center for Journalism and Trauma, une organisation qui se consacre à la promotion d’approches éthiques dans la couverture des traumatismes et de la violence. Fort d’une expérience en journalisme audiovisuel et en réalisation de documentaires, Gavin travaille depuis 2008 comme formateur et consultant auprès d’agences de presse, de sociétés de production cinématographique et d’organismes de soutien aux médias dans plus de 25 pays. Il a été l’un des principaux producteurs du film « Hiroshima » de la BBC, récompensé par un Emmy International en 2006. Il est membre du conseil d’administration de la UK Psychological Trauma Society et a siégé au conseil d’administration de la Société européenne d’études sur le stress traumatique pendant plus de dix ans.
Gavin Rees est conseiller au Dart Center for Journalism and Trauma, une organisation qui se consacre à la promotion d’approches éthiques dans la couverture des traumatismes et de la violence. Fort d’une expérience en journalisme audiovisuel et en réalisation de documentaires, Gavin travaille depuis 2008 comme formateur et consultant auprès d’agences de presse, de sociétés de production cinématographique et d’organismes de soutien aux médias dans plus de 25 pays. Il a été l’un des principaux producteurs du film « Hiroshima » de la BBC, récompensé par un Emmy International en 2006. Il est membre du conseil d’administration de la UK Psychological Trauma Society et a siégé au conseil d’administration de la Société européenne d’études sur le stress traumatique pendant plus de dix ans.