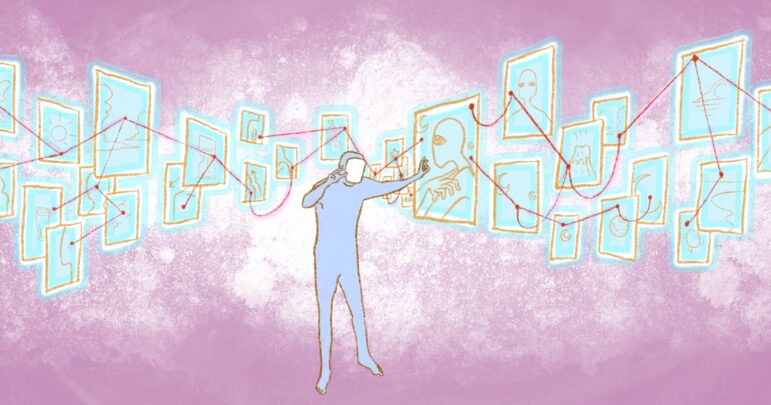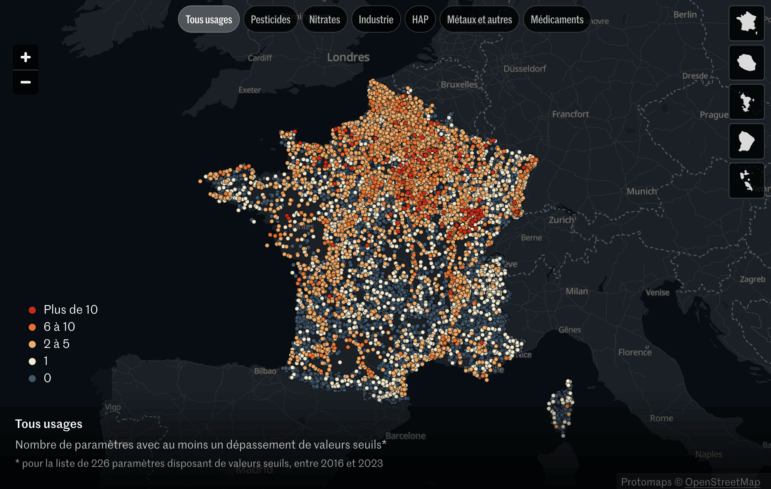La gestion de projet et le rôle de chef de projet dans le journalisme collaboratif
Lire cet article en
Tout a commencé avec Associated Press, une agence de presse à but non lucratif, fondée par six journaux américains au milieu du XIXe siècle. Cette collaboration a permis à ses membres de partager des contenus, ce qui contrevenait parfois à la nature traditionnellement exclusive de l’information. Aujourd’hui, grâce aux avancées technologiques et à Internet, il est plus facile aux reporters du monde entier de travailler ensemble. Ces partenariats permettent aux organes de presse d’avoir une exclusivité géographique, tout en couvrant l’actualité nationale avec une perspective internationale ou en s’intéressant à des questions transfrontalières. Tout le monde y gagne. Le journalisme collaboratif a déjà une longue histoire.
Rôle de la gestion de projet dans le contexte du
journalisme collaboratif
Outre les aspects journalistiques fondamentaux des enquêtes collaboratives, il y a tout un travail en termes d’organisation, de planification, de coordination, de gestion de l’équipe et des parties prenantes, ainsi que de budgétisation et de limitation des risques, travail qui est sous la responsabilité du chef de projet. Ces projets impliquent souvent que les membres d’une équipe, qui ont des compétences diverses, travaillent ensemble. Il peut y avoir des chocs de cultures et de personnalités, et des conflits peuvent survenir. Pour mener à bien une enquête dans les délais impartis, il faut planifier, et, parfois, trouver un budget.
En journalisme, on se concentre généralement sur l’enquête et sur les résultats : la publication des contenus, pendant l’investigation ou au terme de celle-ci, et leur impact. Mais le travail des seuls journalistes ne suffit pas pour atteindre l’objectif et obtenir des résultats : les autres membres de l’équipe jouent aussi un rôle prépondérant.
Par exemple, un organe de presse aura peut-être un photographe, un responsable éditorial, un rédacteur en chef en charge des réseaux sociaux, et un responsable du marketing, de la promotion de l’information et de son impact. Une équipe d’investigation collaborative, petite ou grande, pourra se partager ces rôles ou engager un journaliste indépendant, mais les tâches qui ne sont pas directement liées à l’enquête reviennent au chef de projet. Si personne n’assure la coordination du projet, les objectifs ne seront jamais atteints.
Mais en raison de la nature même du monde de l’information, il est difficile de planifier sur le long terme, les budgets sont souvent limités, et peu de reporters et de responsables éditoriaux bénéficient de formations spécifiques à la gestion de projet, estime Robin Kwong, du Wall Street Journal, qui a rédigé un guide sur le sujet, publié l’an dernier par l’Association pour la gestion de projets, qui propose des conseils aux journalistes. En fait, il en va de même pour le journalisme collaboratif : il n’était pas vraiment nécessaire par le passé, explique-t-il. Ce n’est qu’avec l’avènement des projets transfrontaliers que la fonction de chef de projet est apparue en journalisme d’investigation.
Chef de projet
Le chef de projet, on l’a dit, veille principalement à ce que ce qui concerne l’équipe, l’enquête et la manière dont cette dernière progresse, se passe conformément à ce qui a été prévu. Le chef de projet n’impose rien à l’équipe, mais fait en sorte que ses membres soient synchronisés et en accord. Le chef de projet est là pour s’assurer que ce qui est décidé soit bien décrit, que l’équipe s’organise en fonction de ces accords, et qu’elle réalise ce qui a été décidé conjointement.
Le chef de projet aide l’équipe à suivre les lignes directrices qui ont été élaborées par ses membres, c’est-à-dire les processus à respecter jusqu’à la publication finale. Le chef de projet guide les équipes pendant les moments difficiles ou en cas de désaccords, et s’assure que l’équipe puisse célébrer ses réussites. En bref, le chef de projet veille sur l’équipe, en apportant son soutien, tant aux personnes qu’au projet. Le chef de projet a l’esprit pratique, maîtrise l’outil informatique et est bien organisé. Il sait mener de front une cinquantaine de tâches tout en gardant le sourire.
Le chef de projet n’impose pas de ligne directrice : c’est un leader, qui guide l’équipe et l’aide à surmonter les difficultés que les journalistes d’investigation ne connaissent que trop bien. Faire preuve de leadership, en tant que chef de projet, consiste à accorder une certaine liberté à l’équipe, dans le cadre qu’elle s’est fixé. Comme pour le reste de l’équipe, la confiance est primordiale. Il faut que l’équipe fasse confiance au chef de projet, pour lui donner une mission et pour qu’il soit le leader dont elle a besoin.
Le chef de projet doit avoir des compétences spécifiques, que l’on n’apprend pas dans la plupart des écoles de journalisme, ainsi qu’une bonne dose de patience. Etant donné qu’il travaille sur des projets de journalisme d’investigation, il est important, bien entendu, qu’il comprenne les principes de base du journalisme d’investigation, comment fonctionne le processus d’enquête, ainsi que les obstacles qui peuvent se présenter.
Enfin, le nom du chef de projet ne figure généralement pas en haut de la liste des personnes qui ont contribué à la publication. Il vaut mieux mettre son ego de côté et ne pas aspirer à la célébrité si on veut assumer ce poste.
Compétences requises pour être chef de projet :
- Le chef de projet a l’esprit pratique, maîtrise l’outil informatique et est bien organisé. Il sait mener de front une cinquantaine de tâches tout en gardant le sourire. Les documents type n’ont pas de secrets pour lui, et il adore résoudre les casse-tête. Il est extrêmement bien organisé et a un sens aigu de la collecte d’informations.
- Conciliateur, diplomate et sentinelle : le chef de projet doit veiller à ce que les membres de l’équipe soient d’accord à différents niveaux (voir Protocole d’accord) et se tiennent à ce qui a été décidé, mais il notera et évoquera les changements éventuels. Il se situe à mi-chemin entre le médiateur et l’instituteur.
- Facilitateur, médiateur et interprète : le chef de projet est l’araignée au centre de la toile, qui interprète les besoins de l’équipe, du projet, et parfois même des différents membres (réunions, mises à jour, outils, etc.). Attention à ne pas devenir un secrétaire : soyez un leader !
- En véritable chef d’un orchestre de musiciens hétéroclites, mais qui a une vue d’ensemble, le chef de projet entretient des relations personnelles avec les membres de l’équipe, mais se concentre sur l’objectif : le projet. Soyez le phare de l’équipe.
- Stratège qui gère les parties prenantes et sait travailler en réseau, le chef de projet veille à ce que les travaux et l’équipe soient bien représentés auprès des principaux bailleurs de fonds, des rédactions, voire des tiers (scientifiques, politiques, personnes qui jouissent d’une certaine influence) qui peuvent aider l’équipe à atteindre ses objectifs.
Rien n’est gravé dans le marbre
En journalisme collaboratif, on se demande souvent si le rôle du chef de projet devrait être conjugué à une autre fonction au sein de l’équipe. Mais il y a un risque de conflit d’intérêt : vous exprimez-vous en tant que journaliste d’investigation qui a un point de vue personnel, ou en tant que chef de projet qui a une vue d’ensemble des intérêts de toute l’équipe et du projet ?
Par ailleurs, la question se pose de savoir si cette désignation, ‘gestion de projet’, est adéquate. Pendant longtemps, les mots ‘gestion’ et ‘projet’ n’ont pas vraiment été acceptés dans les milieux journalistiques parce qu’on les associait au monde de l’entreprise et des affaires. Les journalistes semblent plus à l’aise avec ‘coordinateur éditorial’, ‘responsable de la coordination’ ou ‘producteur’ (télévision). Mais maintenant que l’on identifie mieux les mots ‘gestion’ et ‘projet’, et les réalités qu’ils recouvrent, le terme ‘chef de projet’ et, partant, l’utilisation du mot ‘projet’, sont plus courants. ‘Chef de la coordination’ est un équivalent qui convient aussi très bien.
Les horaires d’un chef de projet varient grandement (de quelques heures par semaine à un travail à plein temps, dès le début du projet) et dépendent des besoins de l’enquête et de l’équipe pour obtenir les meilleurs résultats. Il arrive qu’une équipe se rende compte qu’elle a besoin d’un chef de projet après avoir commencé son enquête. Dans certains cas, on nous propose une structure existante, quand on travaille avec des organes d’investigation comme l’OCCRP ou l’ICIJ. Rien n’est gravé dans le marbre. On ne peut pas avoir la certitude qu’un chef de projet fera partie d’une équipe d’investigation, ni quand ni comment, même si un nombre croissant de journalistes d’investigation estiment qu’un chef de projet apporte un plus dans une équipe.
Projets collaboratifs
Dans le monde de l’entreprise, un projet fait généralement référence à une initiative temporaire dans l’objectif de réaliser, à terme, un produit, un service ou un résultat unique. En journalisme, nous avons des points communs : les projets sont limités dans le temps. Ils ne font pas partie du processus habituel des rédactions. Ils commencent et se terminent à des dates précises, et bénéficient d’un budget particulier. Un projet est initié pour atteindre un objectif particulier, qui sort du cadre des opérations courantes. Cela veut dire que l’équipe qui travaille sur le projet peut intégrer des personnes qui ne travaillent pas ensemble d’ordinaire et qui ont besoin de ressources qui sortent aussi du cadre habituel. Un projet, ce n’est pas la routine.
Un projet implique :
- un temps limité : des dates de début et de fin de projet ; un travail qui ne fait pas partie du quotidien habituel d’une rédaction ;
- des membres d’une équipe spécifiques qui travaillent ensemble (et qui ne travaillent pas forcément ensemble habituellement) ;
- des fonds spécifiques ou un budget alloué spécialement ;
- des objectifs précis ou un résultat final particulier.
Le journalisme transfrontalier est une forme de projets collaboratifs bien connue de nos jours. Mais il existe de nombreux types de collaboration. Certaines collaborations n’impliquent que des journalistes indépendants, que des rédactions, ou un mélange des deux.
Quelques conseils sur la manière d’organiser les tâches liées à la gestion de projet :
- Dans une petite équipe (de deux à neuf personnes), vous n’avez peut-être pas envie d’avoir aussi un chef de projet, mais n’excluez pas cette possibilité. Y a-t-il un membre de l’équipe qui est prêt à assumer ces tâches, et qui en a les capacités ? Soyez conscient du risque que vous courez en ayant dans votre équipe une personne qui a deux casquettes. Discutez-en avec l’équipe pour savoir comment vous gérerez cela. Un mentor en gestion de projet, rémunéré par le biais d’un programme spécial, peut aussi vous apporter un soutien pour votre projet. Ou peut-être une personne qui travaille dans l’une des rédactions partenaires est-elle disponible.
- Quelle que soit la taille de l’équipe, le travail d’un chef de projet serait-il bénéfique ? Quelles sont les tâches exactes à remplir, et combien d’heures hebdomadaires ou mensuelles seraient-elles nécessaires ? Tenez compte de cette charge horaire et des coûts induits dans votre planification budgétaire.
- Discutez des tâches du chef de projet au sein de l’équipe, ainsi que des attentes de l’équipe pour maximiser le travail (rappels, coups de téléphone personnels, planning détaillé, etc.).
Pour en savoir plus sur les moyens de trouver d’autres journalistes avec qui collaborer :
- Entretenez-vous avec des personnes qui ont été chef de projet dans le cadre du journalisme collaboratif. Vous pouvez les identifier sur Hostwriter, LinkedIn, The Collaborative Managers Group of investigative journalists (un réseau de pairs sur LinkedIn), Arena Journalism, Journalismfund ou The Directory of European journalism networks.
- Lisez ma newsletter hebdomadaire sur LinkedIn à propos de la gestion de projet en journalisme d’investigation
- Comment faire équipe par N-ost
- Consultez ces deux listes : 12 communautés pour les journalistes que vous devriez connaître ou encore (ce ne sont pas les mêmes) 15 communautés pour les journalistes que vous devriez connaître
- Et reportez-vous à cette base de données pour le journalisme collaboratif
Pour en savoir plus sur le rôle des chefs de projet en journalisme d’investigation :
- Project-Manager-Playbook-FALL2021 (collaborativejournalism.org)
- Conseils pour diriger des équipes de journalisme transfrontalier (IJNET.org)
- Les projets de journalisme transfrontalier sont des processus complexes. Dans son ouvrage intitulé Cross- Border Collaborative Journalism: A Step-by-Step Guide , Brigitte Alfter décrit un parcours de collaboration transfrontalière en six étapes : l’idée d’une enquête peut venir de votre réseau, l’équipe est mise en place, un plan est élaboré, les recherches sont effectuées, l’enquête est publiée, et le réseau s’agrandit.
- Par ailleurs, sur le site Story Based Inquiry, les journalistes peuvent découvrir une méthode très concrète pour lancer une enquête et la mener. Le journalisme d’investigation y est traité comme un processus intégré, axé sur la publication d’un reportage inédit. Cet ouvrage est un guide pour acquérir les bases : comment concevoir une enquête, la structurer, faire des recherches, composer et publier.
- Débuter dans le journalisme d’investigation – GIJN
- Outils et conseils pour enquêter – GIJN
 Coco Gubbels a travaillé comme journaliste d’investigation indépendante pendant près d’une décennie aux Pays-Bas. Aujourd’hui, elle est cheffe de programme et de projet, à plein temps et par intérim, chez VL Consultants BV. Elle gère des projets pour de grandes sociétés nationales et internationales. Et elle est prête à partager ses connaissances et sa passion pour le journalisme. Elle gère le site Project Management in Investigative Journalism , sur lequel elle donne des conseils.
Coco Gubbels a travaillé comme journaliste d’investigation indépendante pendant près d’une décennie aux Pays-Bas. Aujourd’hui, elle est cheffe de programme et de projet, à plein temps et par intérim, chez VL Consultants BV. Elle gère des projets pour de grandes sociétés nationales et internationales. Et elle est prête à partager ses connaissances et sa passion pour le journalisme. Elle gère le site Project Management in Investigative Journalism , sur lequel elle donne des conseils.