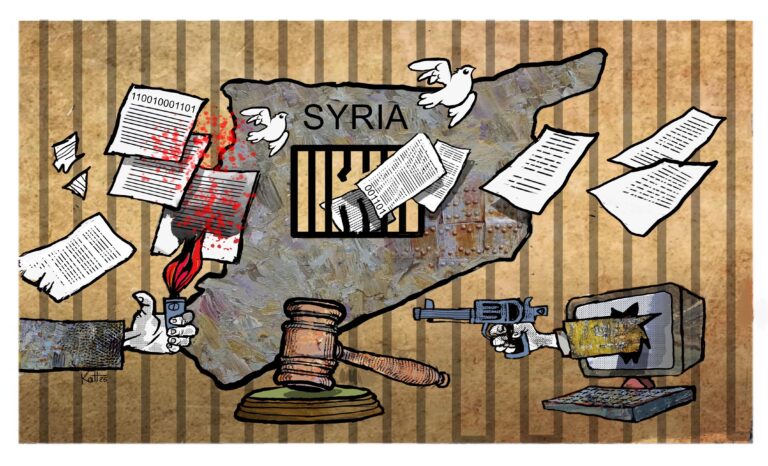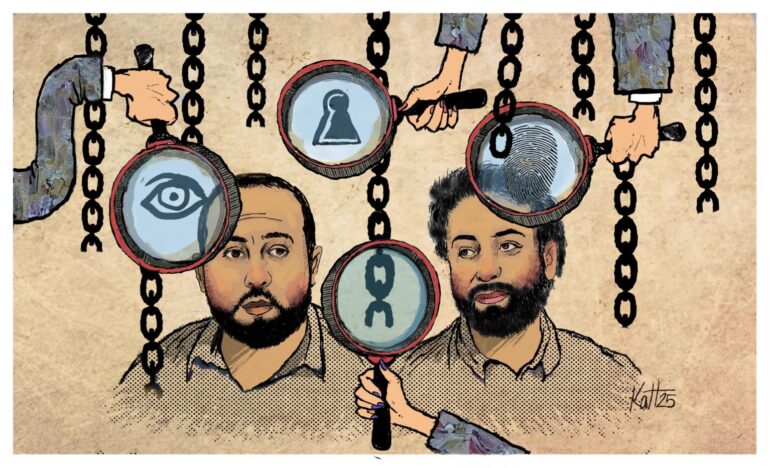Clothes found in a "safe house" in Ciudad Mante, Tamaulipas, Mexico, in January 2017. Photo: Mónica González
Comment un collectif de journalistes a retrouvé 2 000 tombes clandestines
Vêtements trouvés dans un « refuge » à Ciudad Mante, Tamaulipas, au Mexique, en janvier 2017. Photo : Mónica González
Le Mexique est un pays aux nombreuses strates. Déterrer les récits enfouis peut être une tâche à la fois dangereuse et déchirante. Et pourtant, un groupe de reporters et photographes indépendants travaillant dans différentes régions du pays a décidé de se regrouper en un collectif appelé «¿ A dónde van los desaparecidos ?» (où vont les disparus ?) afin de répondre à cette question fondamentale : où sont les disparus ?
Cela fait des dizaines d’années que des personnes disparaissent au Mexique, mais les meurtres et les disparitions connaissent une progression particulièrement alarmante depuis 2006, lorsque le président Felipe Calderón a changé la politique de sécurité du pays, déployant davantage de fonds pour financer des opérations militaires et policières contre les cartels de la drogue.
Au terme de son mandat de six ans, la « guerre contre la drogue de Calderon » avait laissé dans son sillage plus de 47 000 décès liés au crime organisé. Son successeur, Enrique Peña, a promis de freiner la violence, mais celle-ci a continué de grimper. Le taux de meurtres au Mexique (29 pour 100 000 habitants) est trois fois plus élevé qu’en 2007. Plus de 40 000 personnes ont été portées disparues depuis 2006.
Un agriculteur à Iguala, par exemple, a révélé qu’il savait identifier les tombes en repérant des variations dans le sol pouvant indiquer que la terre y avait été creusée.
Des journalistes basés dans différentes régions du pays se sont mis à accompagner les familles dans la recherche de leurs proches. Les familles espéraient les retrouver vivants, mais envisageaient également la possibilité qu’elles puissent être mortes, et leurs dépouilles placées dans des sépultures anonymes.
« Les familles nous ont forcé à ouvrir les yeux », explique Alejandra Guillén, une journaliste mexicaine de Guadalajara, qui a assisté à plusieurs de ces recherches. Elle dit que ces familles se sont organisées en une Brigade nationale de recherche. Elles traversaient le pays pour interrompre des messes et annoncer, avec l’aval des prêtres : « Si vous disposez d’informations, faites-le nous savoir. Nous n’allons pas vous dénoncer. Nous ne sommes pas à la recherche de justice. Tout ce que nous voulons, c’est savoir ce que sont devenus nos proches. »
Des personnes se sont manifestées, dans certains cas chuchotant aux familles une piste de recherche, dans d’autres partageant avec eux une adresse écrite à la hâte sur un bout de papier. Un agriculteur à Iguala, par exemple, a révélé qu’il savait identifier les tombes en repérant des variations dans le sol pouvant indiquer que la terre y avait été creusée. Grâce à lui et à d’autres, certaines familles ont commencé à retrouver des dépouilles.
La couverture médiatique de ces fouilles était difficile. La photographe Monica González raconte que de nombreux collègues se sont effondrés en larmes au cours de leurs reportages. Cette émotion les a poussés à réfléchir et discuter davantage quant à la meilleure manière de raconter le récit de ces disparitions : sur quels éléments devraient-il se focaliser ? que voulaient-ils raconter ? comment enquêter et présenter ces événements au plus grand nombre, sachant l’impact que leur travail aurait sur eux et sur le grand public.
Bertila Parada tient une photo de son fils, Carlos Alberto Osorio Parada, un migrant salvadorien retrouvé dans une tombe avec 12 autres personnes, à Tamaulipas, en 2011. Photo : Mónica González
L’impossible reportage de terrain et l’absence d’une base de données
Marcela Turati, une journaliste chevronnée en matière de droits de l’homme au Mexique, et qui a également contribué à mettre en place des réseaux de soutien entre journalistes de son pays, a été à l’initiative de ce projet en réunissant plusieurs collègues autour de ce sujet d’enquête. Alejandra Guillén a été l’une des premières à répondre favorablement à son appel. Elles avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs enquêtes.
Si la strate contenant les tombes sur lesquelles elles comptaient enquêter étaient recouvertes par de nouvelles dépouilles, il serait impossible d’effectuer des reportages sur le terrain, comme elles l’avaient envisagé.
Les deux femmes avaient prévu de traverser le pays en voiture pour visiter des tombes clandestines identifiées à Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz et Jalisco. Mais avant de commencer leur périple, elles se sont rendues dans un temazcal (une hutte de sudation traditionnelle mexicaine, utilisée pour des rituels curatifs et spirituels), où elles ont demandé protection. Elles devaient se remplir d’ « énergie positive » pour pouvoir affronter toutes les ondes négatives à venir.
Elles se sont d’abord arrêtées à La Barca, Jalisco, à l’ouest du pays, où des corps avaient été retrouvés dans une fosse. Alejandra Guillén n’étant pas sûre de pouvoir trouver l’endroit exact, elles se sont arrêtées dans un petit magasin en bord de route pour y demander leur chemin. La jeune femme qui y travaillait a posé le balai qu’elle avait entre les mains, s’est approchée d’elles et leur a dit : « Si je vous envoie là-bas, je vous envoie dans la tombe. On y enterre encore des gens. » Elle a ajouté qu’il valait mieux qu’elles partent, les « faucons » (les informateurs des groupes de crime organisé) ayant probablement déjà vu leur voiture. Elles sont parties sur le champ.
Si la strate contenant les tombes sur lesquelles elles comptaient enquêter étaient recouvertes par de nouvelles dépouilles, il serait impossible d’effectuer des reportages sur le terrain, comme elles l’avaient envisagé. Suite à cet avertissement, qui a fait ressortir à quel point il était dangereux d’enquêter sur ce sujet, elles ont décidé de travailler à la création d’une base de données ou d’un registre, car il n’en existait pas d’officiel au niveau national. Elles se sont d’ailleurs demandées pourquoi il n’en existait pas.
Elles ont réparti le travail entre elles et plusieurs autres journalistes et ont décidé de déposer des requêtes officielles d’informations auprès de chacun des 32 États mexicains ainsi que du bureau national du procureur général. Alejandra Guillén, qui a toujours été plus une journaliste de terrain que de bureau, voulant voir les choses de ses propres yeux, a fini par déposer de nombreuses demandes d’accès à des documents administratifs, même si elle ne savait pas très bien comment s’y prendre, comme elle l’avoue : « Je n’avais pas beaucoup d’expérience et je ne savais pas quelles données nous pourrions obtenir. »
Des chiffres à faire frémir
Au total, ils ont déposé 197 demandes. Lorsque les premières réponses ont commencé à arriver, ils ont réalisé qu’il n’existait pas de critère ou méthodologie unique suivi par tous les procureurs locaux ou nationaux. Ceux-ci n’employaient pas tous la même terminologie et parfois ne semblaient pas reconnaitre certains mots. À Aguascalientes, par exemple, les autorités ont déclaré ne pas savoir ce qu’était une « fosse ». Interrogées sur le sujet des « cuisines » – le nom donné en langage familier à la destruction des corps au moyen d’acide – ils ont dit ne pas comprendre ce terme.
Certains États ont refusé de fournir les informations demandées. Les journalistes ont dû déposer sept requêtes en appel, défendant qu’il s’agissait de crimes contre l’humanité et qu’il ne pouvait donc y avoir aucune raison de dissimuler les données ou d’en refuser l’accès.
L’enquête a duré près de deux ans. L’équipe, plombée par les faits qu’elle mettait à jour, a dû faire de nombreuses pauses
Pour traiter et organiser toutes les réponses reçues, les journalistes avaient besoin d’une aide supplémentaire. C’est pourquoi Mago Torres et David Eads ont rejoint l’équipe. Avec leurs compétences propres et leur recul, tous deux vivant aux États-Unis, ils ont pu commencer à construire la base de données voulue, en filtrant, en nettoyant et en donnant un sens aux chiffres. En est ressorti qu’ils ne pourraient établir que le nombre annuel de tombes à l’échelle municipale, et le nombre de corps enterrés dans chacune d’entre elles. « Nos chiffres peuvent contenir des erreurs, mais c’est la réalité des informations dont nous disposons », explique Mago Torres.
Une fois qu’ils ont commencé à ajouter, recouper, visualiser et cartographier les données, en tenant compte de trois dimensions (l’espace, le temps et la densité), ils ont enfin pu mesurer l’étendue du désastre.
Une précédente enquête indépendante menée par l’Université ibéro-américaine de Mexico avait révélé 390 tombes clandestines entre 2009 et 2014 dans une partie seulement du pays. Le ministère mexicain de l’Intérieur a signalé 855 cas dans tout le pays. La Commission nationale de recherche, chargée de diriger les efforts de recherche de personnes disparues, a recensé 1 150 personnes. Et la Commission nationale des droits de l’homme a déclaré avoir localisé 1306 tombes de janvier 2007 à mai 2018.
Les données du collectif, qui recouvrent toute la décennie 2006-2016 et tous les États du pays, ont fait ressortir un nombre beaucoup plus élevé que ceux de l’étude universitaire ou des différents rapports officiels : au moins 2000 tombes dans tout le pays, soit une tous les deux jours, dans une municipalité sur sept.
En plaçant les données sur une frise chronologique, ils ont constaté une augmentation du nombre de ces enterrements clandestins à partir de 2006, et ce jusqu’en 2011. Depuis, le rythme est resté constant. Combien des 40 000 personnes disparues entre 2006 et 2018, pendant les présidences de Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto, se trouvaient dans ces tombes ?
L’enquête a duré près de deux ans. L’équipe, plombée par les faits qu’elle mettait à jour, a dû faire de nombreuses pauses. C’est d’ailleurs ce qui a convaincu Mago Torres de l’urgence de terminer le projet : pour leur santé mentale, les journalistes avaient besoin de savoir que leur travail aurait une fin. Elle ne voulait pas que sa salle à manger soit envahie indéfiniment par des sets de données et des cartes de tombes, ni qu’Alejandra Guillén voie des photos de dépouilles pendant ses derniers mois de grossesse. Ils devaient publier leur enquête, et vite.
C’est alors que Quinto Elemento (Le Cinquième élément), un média d’investigation indépendant et un membre du GIJN, leur est venu en aide. « Nous sommes arrivés à un moment décisif, empêchant ainsi le moral de sombrer davantage », explique sa directrice, Alejandra Xanic. Son expérience lui a appris que les projets de recherche sont de nature cycliques et qu’il est parfois bon de faire appel à un soutien extérieur pour les mener à terme.
Quinto Elemento les a aidés à réviser et à éditer cartes et textes. Le média les a également aidés à prendre conscience de l’importance de leur enquête. Celle-ci ne pouvait pas juste paraître dans des médias indépendants ou spécialisés, elle devait toucher un large public. De ce constat a découlé une stratégie de publication ambitieuse qui a porté ses fruits : l’enquête est parue dans 22 médias (15 nationaux et 7 régionaux). 36 autres, dont certains médias internationaux, ont également fini par reprendre ces révélations.
Capture d’écran.
Le silence comme seule réponse
« Ce n’est qu’après le 12 novembre 2018, lorsque nous avons publié les résultats de notre enquête, que nous avons compris la portée sociale de notre travail », explique Paloma Robles, une autre journaliste de l’équipe. Ils étaient imprégnés de leur enquête depuis si longtemps qu’ils ne pouvaient imaginer comment elle serait reçue une fois publiée.
« Nous n’avons pas obtenu toutes les réponses à nos questions, nous avons seulement déterré la première strate » —Alejandra Guillén.
Le récit, « 2 000 tombes clandestines : comment une décennie de lutte anti-drogue a fait du Mexique un cimetière », agrémenté de cartes interactives à l’échelle nationale et étatique, a été publié à la toute fin de la présidence de Peña Nieto. Mais il n’y a eu ni déclaration ni réponse officielle à l’enquête.
Le jour même de la publication de l’enquête, les journalistes ont organisé un rassemblement à Mexico. Des familles à la recherche de leurs proches y ont assisté, dont certaines venues d’autres États, comme le Durango ou le Guerrero. Elles sont restées sans parler pendant que les journalistes ont expliqué les cercles et les nombres représentant les morts sur les cartes figurant dans l’enquête. Quelque temps plus tard, plusieurs de ces familles ont utilisé ces cartes et la base de données des journalistes pour exiger la vérité sur leurs proches auprès des procureurs locaux.
L’équipe de journalistes après avoir reçu le prix Gabo en octobre 2019. Photo : Quinto Elemento.
Questions en suspens
« Nous n’avons pas obtenu toutes les réponses à nos questions, nous avons seulement déterré la première strate », indique Alejandra Guillén au sujet de la base de données et des cartes. « Si quelqu’un veut effacer ces révélations, nous disposons désormais d’un registre. On ne peut plus nier ce qui est arrivé. »
Depuis qu’ils ont publié l’enquête et remporté plusieurs prix (Gabo 2019, Colpin 2019), les journalistes ayant travaillé sur ce projet se posent de nouvelles questions : qui sont les personnes enterrées dans ces tombes ? (Seules 1 738 victimes ont été identifiées.) Pourquoi ont-elles été tuées ? Qui les a tués ? Quand ? Y a-t-il des variations géographiques ou chronologiques ? Les méthodes employées sont-elles toutes les mêmes ?
Ils ont également découvert d’autres cartes réalisées par des journalistes (comme celle-ci, montrant les confrontations entre les forces armées et des civils) qui mériteraient d’être comparées aux cartes des tombes clandestines.
Mais poursuivre ce travail archéologique de plus en plus complexe est une tâche ardue. Cela nécessite non seulement du temps et des ressources qui leur font défaut, mais également du courage en abondance et un moral à toute épreuve.
Les groupes de soutien qu’ils ont créés pendant l’enquête, en personne et sur WhatsApp, ont aidé les membres de l’équipe à gérer leurs peurs et leurs peines. Quand Marcela Turati a reçu des fonds supplémentaires, elle s’en est servie pour financer une thérapie au profit de toute l’équipe. C’était la meilleure décision à prendre, dit-elle, et une leçon importante : « Il nous a fallu un an et demi pour apprendre à gérer la douleur. »
Cet article a été traduit par Olivier Holmey.
Catalina Lobo-Guerrero est la rédactrice en chef du GIJN en espagnol et travaille également comme journaliste indépendante. Elle a réalisé des reportages traitant de politique, de conflits armés, de droits de l’homme et de corruption en Amérique latine, principalement en Colombie et au Venezuela, où elle a été correspondante pendant trois ans.